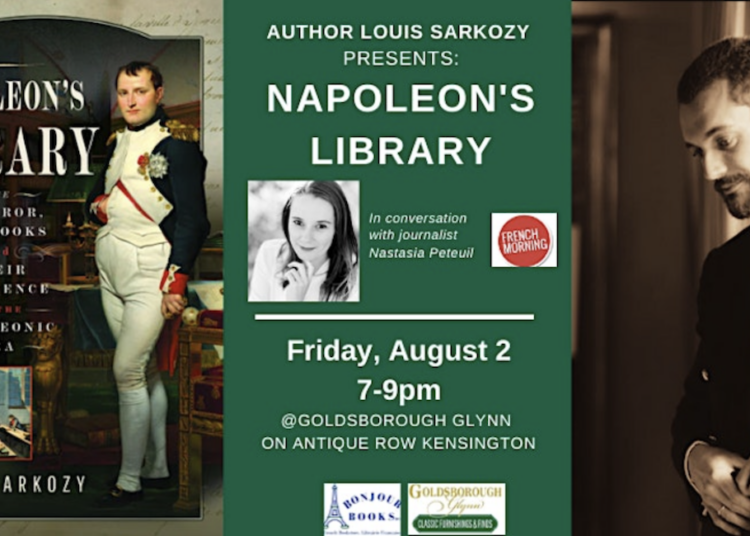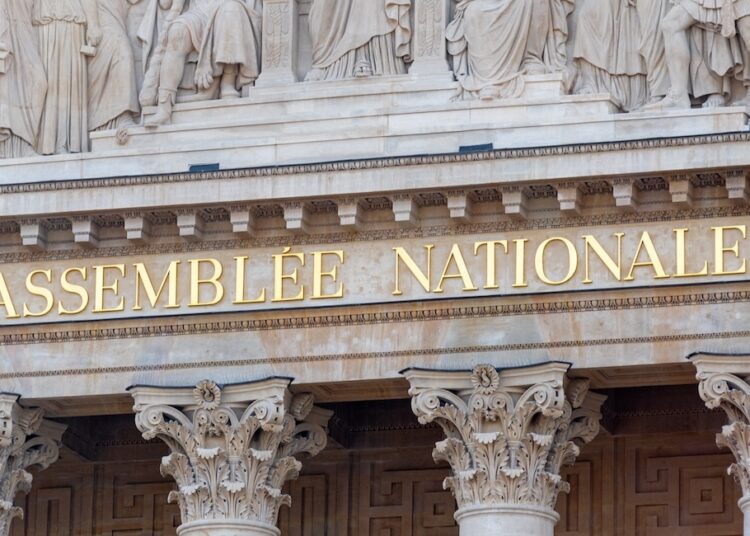Hédonisme et grosses cylindrées
Le Detroit Metro Times, juge « sublime » une réplique du dessin animé « Flushed Away». Lorsque le mercenaire français (« le frog », avec la voix de Jean Reno) lance « on s’en va tout de suite, un de ses hommes lui demande « et le déjeuner ? » , et la voix de Jean Reno corrige « on part dans cinq heures ». Le journal gratuit de Detroit se demande si le penchant français pour la sensualité hédoniste expliquerait le dédain américain pour les Français. Alors que les positions sur l’Irak ont changé, note l’hebdomadaire alternatif, « il serait peut-être temps de mettre notre francophobie de côté et d’embrasser l’ennui existential et les tremblements suicidaires du cinéma français». Suit le programme d’un festival du film français sur le campus.
« Le dîneur ne quittera pas la table au milieu du repas pour utiliser les commodités, et s’il devait y aller, il n’utilisera jamais le mot «{ toilette » en demandant son chemin à son hôte»} relève un article du New York Times qui explique que les Français n’en finissent pas de réapprendre les bonnes manières.
Le journal remarque que « des voitures brûlent et des poubelles sont jetées par les fenêtre dans des banlieues glauques, les attaques physiques et verbales sont plus répandues qu’il y a quelques années, dans le métro, les passagers sont attaqués, les sièges fendus et des graffitis gribouillés dans les wagons…» et observe à côté de ça «un désir de garder, d’encourager et même de vénérer ce que les français appellent la “politesse” ».
La correspondante du New York Times assiste à un cours de bonnes manières. Où l’on apprend que la femme, et non l’homme, doit tendre la main la première pour une poignée de main, qu’une femme mariée doit poser sa main sur l’autre à table pour bien montrer ses bagues et que l’on n’apporte pas de vin quand on est invité à dîner (ça sous entendrait que l’hôte n’a pas bon goût) mais qu’on veillera à arriver un quart d’heure en retard.
Le baise-main survit, note Elaine Sciolino, et elle décrit les pratiques du « maître » en la matière, Jacques Chirac : « Il lève la main de la femme à hauteur de la poitrine et se penche pour la rencontrer à mi chemin. Parfois comme lorsqu’il a rendu visite à la chancelier Angela Merkel à Berlin en mars dernier, il la berce dans ses deux mains. »
On note encore que « 95 % des Français estiment qu’être poli est un atout selon un sondage Ipsos de mars ». Présentez-moi les 5 % de pignoufs restant.
Enorme vroum vroum à Los Angeles. Dans une ville « où les cortèges de dignitaires attirent à peine l’attention », le Los Angeles Times a remarqué la chevauchée de « 15 officiers de police à moto, toutes lumières allumées et moteurs rugissant, escortant 15 flics français à moto pour déjeuner ». « Nous luttons tous ensemble contre le crime international et le terrorisme » commente le consul français à Los Angeles après des explications du quotidien selon lesquelles les policiers français sont là pour dix jours de formation avec la police de Californie, consistant entre autres à s’occuper de la sécurité des Golden Globe Awards (des oscars télé et cinéma) à Beverly Hills…
« La police française qui a fait face à des émeutes l’an dernier dans plusieurs villes dit vouloir apprendre de nouvelles techniques de maîtrise des foules de leurs homologues américains» note le L.A Times. Jerry Reisinger, un agent en retraite qui suivait le cortège « a ri envoyant des agents français sortir leur cigarette et s’en fumer une après avoir garé leurs machines ». A L.A « il y a probablement moins d’un flic sur 100 qui fume».
Le Washington Post et le New York Times consacrent un article au Tent City parisien. Le New York Times explique que « sans domicile fixe » est un « euphémisme français pour les gens qui dorment dans la rue». Il cite le chiffre de 84.000 personnes dormant dans les rues chaque nuit en France, soit « environ le nombre total de SDF dans la seule ville de Los Angeles », « mais même ce nombre dérange le segment socialement actif de la population française » note le quotidien avant d’expliquer comment Médecins du Monde en est arrivé à distribuer des tentes, « le long du Canal Saint Martin, dans le cœur du Paris « bobo » ». Notez que bobo est mis entre guillemets, avec, entre parenthèses, « raccourcis de bourgeois bohèmes ». C’est rigolo qu’un journaliste américain ait besoin de définir bobo pour ses lecteurs : le mot vient du chroniqueur américain David Brooks mais il n’a jamais pris aux Etats-Unis autant qu’en France.
L’auteur.e
Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter