Paul Holdengraber, confesseur d'écrivains
Quand j’ai rencontré Paul Holdengraber à Cambridge, MA, en septembre 90, sa personnalité m’a tout de suite attirée. Francophone, européen par excellence, il était plein d’esprit, drôle, vif, très cultivé, passionné de littérature. Je l’entends encore me raconter comment il avait passé deux heures à commenter pour ses étudiants de Williams College la première phrase d’Un coeur simple de Flaubert. Puis il a déménagé à Miami et moi à New Haven: nous nous sommes perdus de vue. Quinze ans plus tard, je le retrouve à New York sous un titre impressionnant: directeur des programmes Live from the New York Public Library. Grâce à lui, la New York Public Library est devenue un des lieux de rencontres culturelles les plus importants de New York. J’étais curieuse de connaître le trajet qui l’avait conduit de Floride à ce poste.
D’où vient Paul Holdengraber? Il définit son origine comme une bouillabaisse linguistique. Des grands-parents russes et roumains, des parents juifs viennois qui ont quitté Vienne en 1938 pour exercer la médecine à Haïti puis au Mexique où ils ont vécu treize ans, et où est née la soeur de Paul. Lui-même est né au Texas, juste avant le retour de ses parents en Europe. Américain de naissance, il n’a pas mis les pieds aux États-Unis avant un grand voyage en auto-stop à dix-sept ans, juste après son bac. Le douanier tamponnant son passeport vierge l’a accueilli par ces mots: “Welcome home, my boy!” Home? C’est un concept difficile à définir pour Paul. Autrichien et Américain, il a grandi en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Belgique. Il a étudié la philosophie et le droit à l’université catholique de Louvain, puis a suivi les cours de Levinas, de Jankelevitch et de Barthes à Paris avant de partir à Princeton à vingt-deux ans pour y commencer un doctorat en littérature comparée.
Sous la direction de Victor Brombaire, il a entrepris une thèse sur le sujet: “Portrait of the Artist as Collector: Walter Benjamin and the Collector’s Struggle against Dispersion.” De sa thèse, Paul dit aujourd’hui, avec l’humour pince-sans-rire qui le caractérise: “Si vous ne dormez pas à la page 12, vous êtes remboursé.” Mais en attendant il fallait l’écrire, cette thèse, au-delà de la page 12. Paul aimait Princeton, où il aidait à gérer une librairie indépendante et faisait chaque jour des rencontres passionnantes avec des livres ou des personnes; il aimait enseigner le français aux étudiants “undergradués”. À Williams où il a obtenu son premier poste en 1987, il a même reçu des prix de “Outstanding teaching.” Mais la thèse ne s’écrivait pas, malgré les incitations de son directeur de thèse, qui lui disait: “Il y a deux sortes de thèses, Paul: celles qui sont brillantes, et celles qui sont achevées.”
À Williams il a vite senti qu’il n’était pas à sa place. À ses parents venus lui rendre visite, il a fait visiter le campus et la ville. “Mais où est la ville de Williams?” a demandé son père. Le problème était là: pas de ville. Une nature magnifique, des montagnes et des lacs, de la verdure, des arbres: “un endroit merveilleux si tu es un arbre,” a dit l’acteur Jackie Mason, corrigé par la mère de Paul: “Vous avez demandé aux arbres?” Le livre sur les juifs et la nature est un haïku, conclut Paul, qui ajoute avec ardeur: “J’aimerais aimer la nature.” Il s’ennuyait tant dans cette toute petite ville perdue au milieu des collines des Berkshires qu’au bout d’un an il s’est installé à Cambridge, à deux heures de là, au risque de se mettre à dos ses supérieurs hiérarchiques. Comme il n’avait pas terminé sa thèse, cinq ans plus tard on ne lui a pas renouvelé son contrat.
En 1992, Paul s’est retrouvé à l’Université de Miami à Coral Gables. Embauché pour enseigner la littérature comparée, il devait en fait créer le département. L’université intellectuellement médiocre, surnommée “Suntan University,” où il faisait bon vivre, n’était pas exactement le lieu où Paul avait rêvé d’exercer quand il était parti étudier aux États-Unis. Il a tout de suite considéré ce poste comme un “détour dans sa biographie,” un détour dont il a quand même profité pour s’atteler à sa thèse, et l’achever.

Après trois ans de soleil et de pamplemousses, la chance lui a souri. Il a postulé pour une bourse de recherches au Getty Museum à Los Angeles. Cette année-là le thème était la collection. Il l’a obtenue. Parti pour un an, il a tout liquidé en Floride, certain qu’il n’y retournerait pas. Au Getty, il était entouré de gens extraordinaires. Il habitait Venice. On lui avait dit qu’il détesterait LA. Il a adoré. Il aimait conduire en écoutant la radio. Il est resté une deuxième année au Getty, puis a été embauché en 1997 au LACMA, the Los Angeles County Museum of Art, où il a créé “The Institute for Art and Culture.” Il avait une idée: que le mot “institute” soit un verbe, pas un nom. Il s’agissait d’initier, d’instituer. Pendant sept ans il a créé les programmes du musée, et a invité plein de gens. Parallèlement on lui a proposé une émission de radio sur NPR: “Le rôle de l’historien comme juge.” En 97 il a également rencontré sa future femme, Barbara, décoratrice de plateau. Sam, leur fils aîné, est né en 2001.
–p–
Entre la programmation du LACMA et l’émission de radio, Paul a compris qu’il avait trouvé sa voie—sa voix, littéralement. Il a découvert qu’il était un homme de parole, pas d’écriture. Ou plutôt: un homme sachant donner la parole aux autres, sachant écouter. C’est par la parole qu’il a retrouvé le sens originel du mot “université,” qui se perd le plus souvent dans les petites luttes intestines des campus: l’univers. La revendication de Paul, c’est qu’il n’est spécialiste de rien. Il reste ouvert.
Le directeur de la NY Public Library, Paul Leclerc, l’a contacté en 2003: “I heard so much about you.” Il est allé chercher Paul Holdengraber à Los Angeles: “We need you. I want you to oxygenate the library.” Le jeune couple, peu tenté par New York, a finalement accepté.
À New York, Paul Holdengraber s’est retrouvé à faire le même métier qu’à Los Angeles, mais sur un beaucoup plus grand plateau. Il avait soudain la possibilité d’inviter le monde entier. Il a commencé par changer le titre du programme, qui s’appelait alors “Public Education Program,” ou “PEC”: “On aurait dit le nom d’un médicament qu’on prend quand on a mal au ventre.” Il a modifié l’heure des rencontres, de 18h à 19h, ce qui a provoqué une petite révolution interne. De 60 ans, la moyenne d’âge du public est passée à 45 ans. Il y avait 500 personnes sur la liste email, il y en a maintenant 20000. C’est un public de tous bords, de tous âges, de toutes cultures, de toutes origines—mais racialement encore trop homogène selon Paul Holdengraber, qui cherche le moyen de dépasser aussi cette frontière.
Quitter New York? Paul n’y pense plus, sans savoir encore de quoi l’avenir sera fait. Quand il est arrivé ici, il se sentait agressé par la ville, par son rythme frénétique, par son bruit, par la cohue dans le métro. Maintenant qu’il a bu à la coupe, il ne peut plus imaginer de vivre ailleurs. Son fils cadet est né en 2005, et la famille s’est installée à Brooklyn, où Sam est entré en Kindergarten à P.S. 58, qui offre depuis cette année une classe bilingue française et américaine. On a proposé à Paul Holdengraber d’autres postes, plus rémunérateurs, hors de New York: diriger un grand centre culturel, présider une université. Il les a refusés. Il ne se voit pas en “fundraiser.” Il a trouvé sa vocation: rendre la culture jouissive, aphrodisiaque. Il est conscient de sa chance: il peut rencontrer les écrivains, les intellectuels, les musiciens, les hommes politiques du monde entier, et créer des étincelles de pensée vivante en les faisant se rencontrer. Hier il est allé au consulat polonais pour y discuter avec Adam Michnik. Demain il part à Lyon interviewer l’écrivain italien Carlo Ginsburg. Dans six mois, les deux écrivains se retrouveront sur le plateau de Live from NYPL.
Paul Holdengraber crèe quatre-vingt programmes par an. Au moment du Pen World Voices, le festival international de littérature qui se tient début mai à New York, il a organisé neuf événements en six jours. Il donne des conférences, et il fait une émission de radio sur NPR, diffusée dans presque tout le pays. Il n’attend plus que l’émission de télévision, reconnaissant que son ambition serait d’être le prochain Charlie Rose. Quoi qu’il en soit, son métier doit rester une passion.
Sans doute n’est-ce pas un hasard si, après un long détour qui l’a conduit de Princeton dans les Berkshires, du Massachussets en Floride puis en Californie, Paul Holdengraber se retrouve aujourd’hui à New York. Sans doute a-t-il toujours été newyorkais: la frénésie de la ville, c’est aussi celle de son tempérament passionnément curieux, grâce auquel il concilie la culture du monde d’hier et l’ouverture au monde cosmopolite de demain.
Site des rencontres: www.nypl.org/live

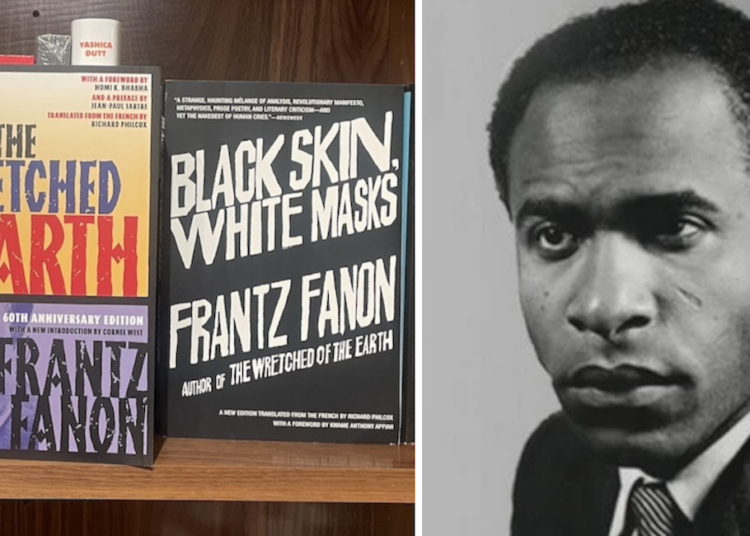








![Caption reads, "[View of the huge crowd from the Lincoln Memorial to the Washington Monument, during the March on Washington]" Original black and white negative by Warren K. Leffler. Taken August 28th, 1963, Washington D.C, United States (@libraryofcongress). Colorized by Jordan J. Lloyd. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA https://www.loc.gov/resource/ds.04417/](https://frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/02/caption-reads-view-of-the-huge-crowd-from-the-lincoln-memorial-to-the-washington-monument-during-the-march-on-washington-original-black-and-white-negative-by-warren-k-leffler-taken-august-28th-1963-wa-stockpack-unsplash-scaled-e1738531807583-750x536.jpg)
0 Responses