Où prendre le pouls de la campagne française ?
«La France n’est pas un pays comme les autres» a dit Jacques Chirac dans ses adieux. «Les Français chérissent leur spécificité avec une férocité à la fois attachante et profondément ennuyante», explique l’éditorialiste David Ignatius dans le Washington Post mais ils «semblent reconnaître que les règles du jeu sont en train de changer». Preuve en est, les trois candidats qui pourraient succéder à Chirac rompent avec le style politique traditionnel français.
D’abord Nicolas Sarkozy, «un américanophile impatient de se faire prendre en photo avc le président Bush à la Maison Blanche à l’automne dernier, ce qui est déjà plus que ce qu’on pourrait dire de la plupart des Républicains du congrès». David Ignatius relève que «beaucoup de français aiment secrètement les importations américaines comme le jazz et les films d’Hollywood, mais Sarkozy aime aussi l’économie de marché». Politiquement, selon lui, l’élection de Sarkozy «marquerait une franche rupture avec la tradition gaulliste de la politique étrangère française, qui se définit depuis les années 1950 en réaction (et souvent en opposition) à l’hégémonie américaine». Il croit que Sarkozy «serait entre autres, plus proche d’Israël et moins automatiquement sympathique aux Arabes que les récents présidents français».
L’élection de Ségolène, aussi, serait un changement. Entre autres parce qu’on a là «une mère de quatre enfants pas mariée(ce qui aide plus que ça ne lui nuit dans un pays qui aime les enfants mais est de plus en plus indifférent au mariage)».
Et Bayrou, aussi, écrit-il mais là, sa démonstration est moins claire.
Changement et résistance au changement, c’est aussi le thème d’un reportage du Los Angeles Times à Evreux, une petite ville française typique avec une cathédrale, des boulots qui partent à l’étranger et des émeutes dans les quartiers.
Le changement en France, ça marche comme les travaux de voirie à Evreux. «Quand un nouveau maire a annoncé une révision du système routier, tout le monde était d’accord pour dire que ça devait être fait. Mais dès que les équipes de construction ont commencé à attaquer les rues, les habitants ont essayé de les arrêter.» «Non», écrit le journal en français, «ça faisait trop de bruit», «c’était pas bien fait», et «il fallait le faire plus tard, peut-être après les vacances». Pour les lecteurs monolingues, le journal précise que «le mot «non» est très populaire en France».
Le
New York Times est allé dans une autre de ses villes qu’on a du mal à placer sur une carte: Auxerre. Une autre ville typique, encore plus typique puisque Auxerre a voté comme la France depuis les élections de 1981. Note au Los Angeles Times qui écrivait qu’Evreux avait «un taux de chômage élevé de 9%», Elaine Sciolino note dans le New York Times qu’à 9 % le taux de chômage d’Auxerre est un peu en dessous de la moyenne française.
A Auxerre, «oasis d’ “équilibre et de sérénité” selon le maire», Bayrou arrive en deuxième position derrière Sarkozy. Restent aussi 46 % d’indécis. Les deux Sarkozy et Royal sont «deux figures polarisantes qui n’inspirent pas confiance». Un employé de café fait remarquer que Bayrou espère avoir le vote des agriculteurs parce qu’il fait du tracteur. «Sarkozy aime faire du vélo, moi aussi, et c’est pas pour ça que je vais voter pour lui». Les indécis sont d’autant plus indécis que depuis que Le Pen s’est retrouvé au second tour des élections de 2002, «les Français n’ont plus le luxe de voter avec leur cœur au premier tour».
Le New York Times consacre aussi un long article à la nouvelle bataille pour l’identité nationale des élections présidentielles françaises, «un sujet longtemps monopolisé par l’extrême droite». Nicolas Sarkozy a proposé la création d’un ministère de l’immigration et de l’identité nationale. La correspondante du quotidien souligne que le candidat «qui a largement évité les banlieues pendant sa campagne, a critiqué les immigrants qui résistaient au modèle français d’intégration». Quant à Ségolène, bien qu’elle ait critiqué l’idée de Sarkosy, «elle lui a emboîté le pas en se drapant dans un manteau de nationalisme», du chant de la Marseillaise à la fin de ses meetings au drapeau tricolore que la candidate voudrait que les Français aient chez eux.
Baston en France. Pas à la gare du nord, mais sur Second Life raconte le Washington Post qui détaille l’attaque du QG virtuel de Jean-Marie Le Pen. Les quatre grands candidats de la présidentielle française ont installé leurs quartiers sur Second Life. «L’intérêt pour la campagne présidentielle française est si fort que grâce aux visites aux cyber-sièges (des partis), la France est le pays à avoir le plus d’avatars sur Second Life», note le Washington Post. Et à côté de ce qui se passe dans les QG de campagne français de Second Life, ceux «des candidats américains sont des villes fantômes». On a même vu une cyber femme en cyber string dans le cyber bureau de cyber Sarko…



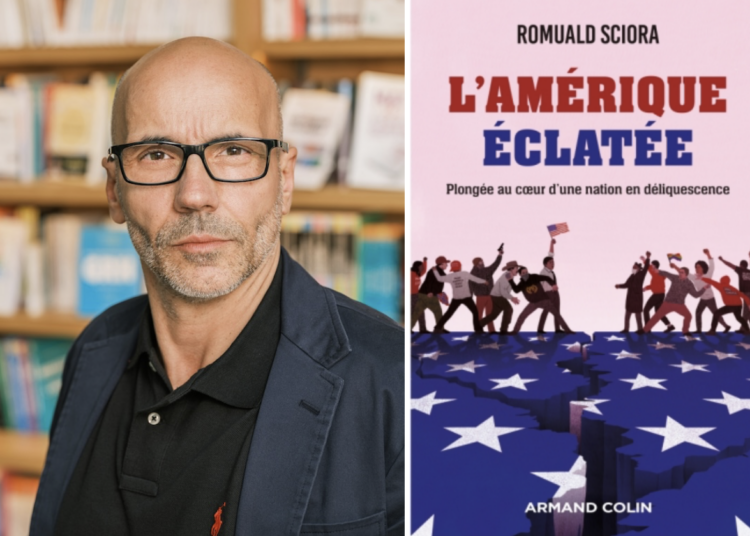
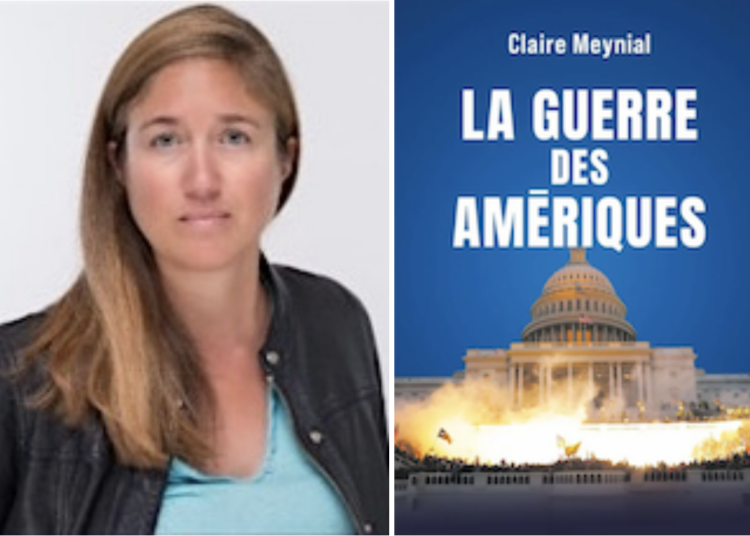






0 Responses
Je supporte de moins en moins ces journalistes américains narquois (notamment le Wahington Post) qui n’ont de cesse que de dire à propos de la campagne :
“Ah vous voyez vous les Français, vous aussi vous vous y mettez au libéralisme, à l’anti-arabisme, et à l’efficaçisme, et au rejet de la vanité culturo-intellectuelle. Vous comprenez enfin que ça ne vaut pas tripette, l’exception française”(qu’ils associent au “communisme rampant” couplé à un “élitisme fin-de-race”, y’a qu’à voir la représentation des Français dans le cinéma US !).
Le genre de collègue chipie qui se dit ta copine, attend que tu te plante, et te dit “peuh, j’te l’avais bien dit”.