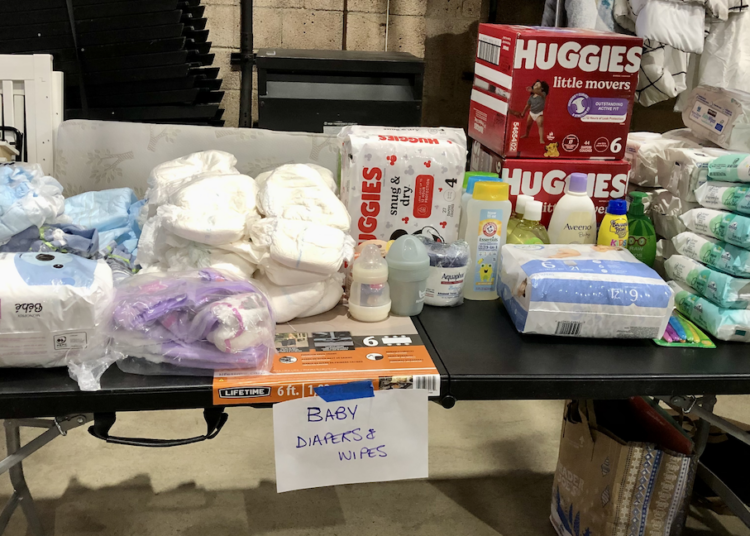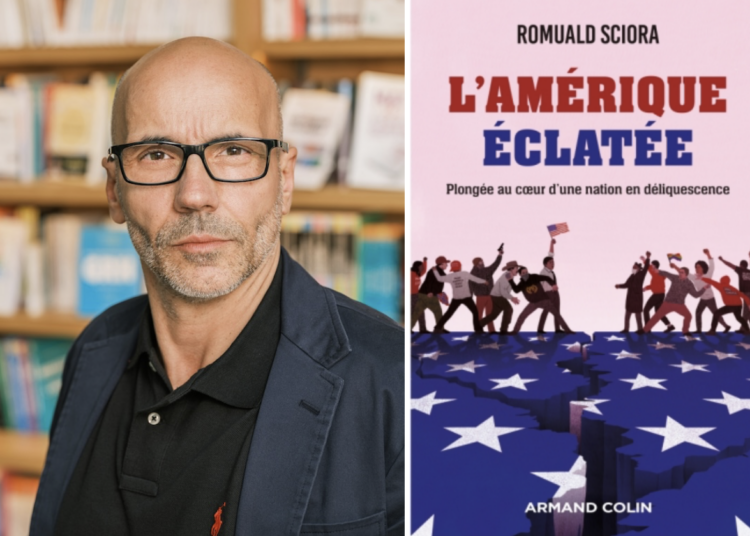Leila Slimani: "J'ai peur d'écrire de la m***e"
Elle n’est pas emballée par le titre américain de son roman Chanson douce –The Perfect Nanny– qu’elle trouve utile à des fins marketing à défaut d’être plaisant. Mais cela n’empêche pas Leila Slimani d’assurer une promotion tambour battant aux Etats-Unis, depuis quelques jours.
Avant de présenter ce roman au festival de littérature PEN World Voices à New York le 16 avril et à la Librairie Albertine le 21, l’auteure franco-marocaine a fait escale à San Francisco, Los Angeles, en passant par Berkeley et Stanford. “J’avais très envie de découvrir le milieu intellectuel américain et le domaine universitaire”, avoue-t-elle. “C’est un pays dont on se sent très familier, de par la littérature et le cinéma. Et pourtant, il nous étonne sans cesse.”
Pas question de tourisme pour cette visite sur le sol américain, mais de relations humaines, et un peu de féminisme et de francophonie, les deux autres sujets de prédilection de la récipiendaire du Goncourt en 2016, première Marocaine à recevoir le prestigieux prix littéraire. “Je suis en train d’écrire un reportage sur mon ressenti sur le mouvement MeToo”, raconte celle qui combat dans ses écrits la loi du silence et l’hypocrisie des sociétés patriarcales, notamment au Maroc dans Sexe et Mensonges: La vie sexuelle au Maroc.
Pas un thriller
Mais Leila Slimani recentre rapidement la conversation sur son actualité. Sortie en janvier aux éditions Penguin, la version américaine de Chanson Douce (déjà traduit en 43 langues) a reçu un “bon accueil” aux Etats-Unis, avec plus de 200.000 exemplaires déjà tirés. “Il y a beaucoup d’intérêt pour l’histoire”, reconnaît-elle.
Nombre de lecteurs -et de journalistes- ont pensé que son roman narrait un fait divers : en 2012, deux enfants ont été massacrés par leur nourrice Yoselyn Ortega à Manhattan. “J’avais déjà commencé à écrire le roman sur les relations entre une famille et une nounou. Quand j’ai vu ce fait divers à la télévision, il m’a inspiré l’idée du meurtre. Commencer le roman par ça était une technique narrative pour attraper l’attention du lecteur”, défend l’auteure de 36 ans, fatiguée que les journalistes américains lui demandent si elle suit le procès new-yorkais -qui se déroule actuellement. “Mais l’histoire n’a rien à voir, ce n’est ni un thriller, ni une enquête.”
N’y voyez pas non plus de similitudes avec Gone Girl (de Gillian Flynn), auquel son livre est maladroitement comparé, selon elle. “Ce qui m’intéressait, c’était le personnage de la nounou, parler de l’organisation de la vie familiale. Le foyer est, malheureusement, souvent occulté.” Au final, The Perfect Nanny traite des relations “de solidarité avec une compréhension silencieuse, mais aussi de violence car il existe une relation dominante et illégale entre la mère et la nounou”. Mais il questionne également ce que cela représente d’être une femme ; est-ce que l’on peut tout avoir, et comment on le vit.
Un langage commun
L’auteure au style incisif aborde un thème universel. “Etre mère ou père recouvre la même émotion, où que l’on vive”, souligne-t-elle. Les protagonistes du roman, les parents Myriam et Paul, un couple de bobos parisiens, sont également transposables d’un pays à l’autre. “Les habitants de San Francisco, comme de New York, les trouvent réalistes : c’est un couple urbain, ouvert d’esprit, qui vit dans un quartier gentrifié, décrit-elle, et pour d’autres, ce sont des figures élitistes, ne se rendant pas compte des réalités”.
Malgré un langage commun des sentiments, elle a remarqué chez ses lecteurs de ce côté-ci de l’Atlantique un rapport différent à la littérature : “les Américains attendent une morale à l’histoire, cherchent un méchant et un gentil ; alors que les Français sont davantage éduqués à l’ambiguïté, à trouver un flottement à la fin du livre.”
Leila Slimani pourrait bientôt être amenée à revenir aux Etats-Unis, en dehors de son rôle d’ambassadrice de la francophonie. Son premier roman Le Jardin de l’ogre sera vendu sur le sol américain courant 2019. En attendant, elle ne chôme pas. Entre deux interviews promotionnelles, elle planche sur son nouveau livre, “un roman assez sombre”. Comme elle dit, “je n’ai pas vraiment peur de la page blanche, mais peur d’écrire de la m***e.”