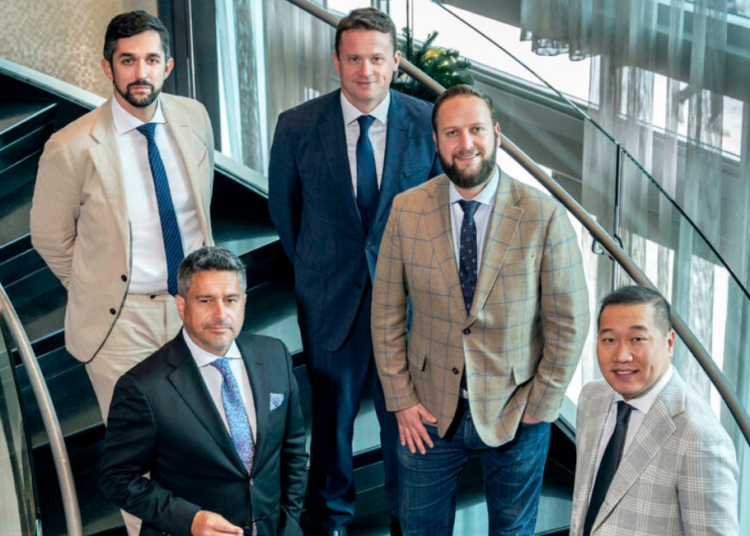Karine Rougé, CEO Veolia Municipal Water : « Aux États-Unis, c’est impardonnable de ne pas être clair »
Aux réunions de la National Association of Water Companies, haut lieu du lobbying des opérateurs privés du traitement de l’eau aux États-Unis, cherchez l’intrus. Dans un parterre d’hommes blancs aux cheveux grisonnants, républicains canal historique pur jus, férus de golf et de bons cigares, Karine Rougé fait exception. Non contente d’intégrer ce club fermé et très old school, elle en assume cette année la présidence. Une première : jamais une femme, de surcroît sensiblement plus jeune que ses collègues, et une Française, n’a tenu ces responsabilités.
Karine Rougé rejoint Suez en 2010, après cinq ans de banque d’affaires chez Goldman Sachs. C’est le début d’une longue carrière chez le géant français de la gestion de l’eau et des déchets, qui l’amènera en 2015 aux États-Unis. En Pennsylvanie d’abord, puis à Paramus dans le nord de l’État de New York. En 2022, Suez prend les couleurs de Veolia, et Karine Rougé dirige depuis la filiale en charge des contrats du traitement de l’eau à tous les niveaux : État fédéral, États et municipalités.
Veolia North America est le premier opérateur d’eau privé aux États-Unis, en termes de population couverte, avec 20 millions d’Américains dans une quarantaine d’États sous son escarcelle, et une équipe de 4000 personnes réparties sur 500 sites. Karine Rougé partage avec nous quatre leçons de ses dix années aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout est « ultra-local »
« Quand on fait des affaires au cœur des États-Unis, une compréhension fine de la culture de chaque État est indispensable, souligne-t-elle. Dans mon secteur, il est impossible de faire du business si on n’est pas implanté localement. De fait, le gestionnaire du site local est souvent plus important que le ou la CEO ! »
La Française, qui voyage beaucoup, décrit un pays très fragmenté, avec des cultures locales très fortes : « Même entre le nord et le sud du New Jersey, les codes sont très différents, on ne fait pas les mêmes blagues ! Et pour faire du business en Pennsylvanie, pensez à réviser vos classiques du Boss, aka Bruce Springsteen, car il est souvent cité dans les conversations. » Selon elle, le socle de référence culturelle partagé par tous les Américains est ténu, beaucoup plus qu’en France par exemple.
Le sport comme facteur d’unité culturelle
Face à cette fragmentation culturelle, il reste néanmoins une référence commune très forte, qu’il est important de maîtriser au mieux : le sport. « Il est beaucoup plus utile de s’y connaître en sport que d’avoir vu les dernières productions de Hollywood ! » constate Karine Rougé.
De ce côté-là, elle a un atout certain : deux fils passionnés de baseball, qui lui ont communiqué leur passion pour les Yankees – même si le Evil Empire n’a pas toujours bonne presse dans l’Amérique profonde : « Je me suis vite rendue compte que les New-Yorkais et les Yankees ne sont pas toujours accueillis les bras ouverts en Amérique », raconte Karine Rougé. Dire qu’on a choisi les États-Unis comme sa patrie d’adoption, en revanche, aide à créer des liens.
Un bon manager est un manager simple et clair
« Je trouve qu’il est plus facile de manager des équipes aux États-Unis qu’en France ou en Europe, souligne-t-elle. Les relations sont plus simples, du moment que le manageur est extrêmement clair dans ses directions. Aux États-Unis, c’est impardonnable de ne pas être clair ! » Simplifier à l’extrême, donner des objectifs très précis, se concentrer sur l’exécution plutôt que sur la beauté d’un raisonnement ou d’une pensée complexe, et répéter souvent : autant de techniques de management auxquelles les Français ne sont pas toujours habitués.
« Ici, on peut fixer des objectifs très ambitieux, trop ambitieux même parfois, du moment qu’ils sont clairs. Les équipes américaines se concentrent sur l’exécution, et sont d’un naturel très optimiste – ça s’apparente presque à de la méthode Coué parfois » apprécie Karine Rougé. En contrepartie, il reviendra au boss d’investir le temps et les ressources nécessaires dans le projet : « Il faut montrer de l’ambition, c’est motivant pour tout le monde. »
Networker sans complexe
« J’ai mis du temps à être à l’aise avec le networking, confie-t-elle. Je trouvais cela faux et superficiel, j’avais l’impression de me mettre en position de vulnérabilité et j’avais peur de ne pas apporter autant aux gens avec qui je networkais que ce qu’ils m’apportaient. »
Aux États-Unis, le networking est beaucoup plus naturel et décomplexé : « Mon expérience américaine m’a fait évoluer : ici le networking est très convivial, et il a un côté transactionnel assumé qui est très sain. Tout le monde comprend l’importance de réseauter, et j’ai noué des relations professionnelles réelles dans ces moments un peu artificiels. »