“Pourquoi vivez-vous à New York? » ai-je demandé à Alain Kirili dans son loft de Tribeca, vaste espace servant d’écrin à ses hautes sculptures.
« –À cause de la seconde guerre mondiale.
–De la seconde guerre mondiale? Mais vous n’étiez pas né!”
Il s’explique: entre les artistes qui ont été déportés et ceux qui ont émigré aux États-Unis, la seconde guerre mondiale a créé une radicale destruction du milieu artistique en France. À la fin des années soixante, quand Alain Kirili avait vingt ans, il n’y avait pas de milieu artistique à fréquenter à Paris, seulement des artistes trop célèbres et trop vieux (Max Ernst, Picasso, Calder, Man Ray…) Pour Kirili, la création est indissociable d’un milieu artistique et d’échanges avec d’autres artistes. Parisien et fils d’industriel, il s’est mis à étudier l’art moderne et contemporain tout seul, en autodidacte, dès l’âge de treize ans, guidé par un petit libraire de l’avenue Mozart qui lui a recommandé des ouvrages sur l’art abstrait.
1) 1965: la découverte de l’Amérique
Quand il passe son bac en 1965, il demande à ses parents de lui offrir un billet charter pour aller aux États-Unis. Il part avec quelques amis et sillonne l’Amérique en bus Greyhound. C’est le choc: il découvre le musée d’art moderne de New York, la Barnes Foundation, le musée des Beaux-Arts de Philadelphie, les musées de Chicago, de Washington, de Baltimore. Un double choc: il réalise d’abord que pour être français, il faut être aux États-Unis. L’identité culturelle française est sublimement présentée dans les musées américains. Il n’a jamais vu autant de Cézanne, de Matisse, de Picasso. Mais il s’aperçoit aussi que le dynamisme d’artistes américains comme Rothko, Pollock ou David Smith—dont il a déjà admiré une sculpture au Musée Rodin au printemps 65—n’a pas d’équivalent en France.
Impressionné par la culture des Américains, le jeune Kirili retire de ce voyage l’impression que l’artiste sans tradition, sans transmission, libre, n’est plus l’Américain, mais le Français. Il a tout à apprendre: des Américains.
2) Entre Paris et New York: Sonnabend et les années d’échange
De retour en France il fréquente une galerie américaine de Paris, Sonnabend, où il rencontre Rauschenberg. D’abord peintre, il se met rapidement au modelé, et au métal. Il sculpte la nuit et le weekend, et travaille de jour dans l’industrie. Après son bac, refusant d’entreprendre des études commerciales comme le souhaitaient évidemment ses parents, il a dû accepter un compromis et faire des stages dans des entreprises en Allemagne pour apprendre le métier. Il n’a pas été mécontent de se retrouver à Berlin où l’art aussi était vivant, transmis par un artiste comme Joseph Beuys. À Paris, la galerie Sonnabend lui ouvre les portes pour une première exposition collective en 1972.
Pendant les années qui suivent, Kirili mène une double-vie. Il gagne sa vie en costume-cravate tandis que son travail d’artiste s’affirme et qu’il multiplie les voyages à New York. Il échange son appartement dans le XVème arrondissement avec un artiste ou un critique d’art désireux de passer du temps à Paris. Il rencontre ainsi Annette Michelson et Rosalind Kraus, les fondatrices de la revue October—comme à Paris, il fréquente Sollers et le milieu Tel Quel.
Il se distingue de ses contemporains français par son attitude pro-américaine. Dans les années soixante-dix en France, un certain anti-américanisme est de bon ton, surtout parmi les jeunes et la gauche. Les États-Unis, c’est le pays du capitalisme impérialiste. Il y a en France, selon Kirili, une fascination/détestation de l’artiste américain. La France, c’est le pays de la haine de soi. En Amérique il découvre le respect de l’autre. Sur la suggestion de Rauschenberg, il lui téléphone lors d’un passage à New York, et le grand artiste américain l’invite à dîner avec une vingtaine d’artistes, de critiques et de collectionneurs. Ils ont beau tous développer des formes très différentes les unes des autres, leur cotoiement leur permet de s’épanouir parce qu’il s’appuie sur le respect du pouvoir symbolique de la création.
3) 1980: l’installation à New York
Au bout de quinze ans, alors qu’Alain Kirili est fatigué de voyager et de toujours habiter chez les autres à New York, une opportunité se présente: un groupe d’artistes crèe une co-op dans un immeuble industriel au sud de Canal Street. Kirili se joint au groupe et achète un loft de 3000sq ft pour $20,000. Il s’agit d’une aventure: à l’époque, le quartier qu’on appelle aujourd’hui “Tribeca” et qui est devenu un des plus élégants et recherchés de New York est un vrai no man’s land. Il n’y a pas un seul magasin où acheter du lait à un kilomètre à la ronde. Kirili doit aller faire ses courses dans un supermarché de Bleecker Street, dans le Village. Soho, entre le Village et Tribeca, est encore un quartier uniquement habité par des artistes. Quant au sud de Canal, personne n’y vit: c’est la zone. Mais le loft qu’achète Kirili se trouve juste en face de l’atelier qui avait appartenu à Barnett Newman, et cette géographie symbolique lui plaît. Il emménage à New York, cesse son travail alimentaire, et enseigne pendant quelques années à la School of Visual Arts.
4) Un artiste français au pays du puritanisme
Alain Kirili se sent franco-américain. Il n’a pas eu besoin de perdre son identité d’origine pour vivre à New York et être américain. Mais il reste un Français au pays des Américains, et sent la différence. La France, dit-il, est un pays de traditions catholiques alors que la démocratie américaine est celle de la Réforme. À l’époque où Kirili commence à s’intéresser à cette question du puritanisme, à la fin des années soixante-dix, personne encore n’en parle. Il lui semble que l’art minimal et conceptuel sont des formes d’art puritaines.
C’est une tradition dans laquelle, en tant que Français, il ne s’inscrit pas. Son activité de sculpteur consiste pour lui à faire face au problème de l’incarnation. Ses sculptures sont de forme épurée, mais il insiste sur le fait qu’elles produisent aussi un bonheur tactile. Pour les Américains, il reste un artiste français, et l’artiste français est pour eux une entité ingérable: luxe, calme et volupté. Les statues de Kirili se dressent vers le ciel, et leur forme phallique, suggère-t-il, est une provocation pour une Amérique contente de mettre Priape au sol et de l’écraser.
Cette différence d’attitude et de rapport au monde ne l’empêche pas d’être reconnu dans un pays comme dans l’autre. En 1984 le MOMA, le Musée d’art moderne de New York, acquiert sa sculpture en fer forgé Cortège. En 1986 son Grand Commandement Blanc est exposé au jardin des Tuileries. De nombreux musées de France possèdent des oeuvres de lui. En juin 2007 sa sculpture Hommage à Charlie Parker a été inaugurée près de la Bibliothèque François Mitterrand à Paris.
Après trente ans de vie à New York, Alain Kirili reste français et se revendique français. Il passe les étés dans le Sud de la France, il a besoin du contact avec la Méditerranée, et il est marié à une Française, la photographe Ariane Hopez-Luici, qui tient le fil grâce auquel il ne s’égare pas au pays des puritaures.
5) Un artiste de l’échange
Ce qui reste essentiel pour lui, c’est l’échange, comme en témoignent ses deux dernières expositions: au Musée de l’Orangerie à Paris, “Kirili et les Nympheas,” (été 2007), dialogue avec Monet; à la galerie Salander-O’Reilly à New York, “Alain Kirili et Gaston Lachaise” (printemps 2007). Cette dernière exposition est particulièrement chère à Kirili car elle lui a permis de montrer qu’il existait une tradition franco-américaine aux États-Unis. Gaston Lachaise, mort en 1935 et beaucoup plus connu ici qu’en France, est le premier sculpteur à avoir eu une rétrospective au MOMA. D’autres noms s’inscrivent dans cette tradition: Houdon, Gaston Lachaise, Marcel Duchamp, et Louise Bourgeois, une amie de Kirili.
Mais il n’est pas franco-français, justement parce qu’il ne supporte pas les frontières qui enferment. De même qu’il a favorisé les échanges entre les artistes et entre les nationalités, il croit à l’échange fructueux entre toutes les formes d’art. Le rythme traverse tous les arts: il n’imagine pas un monde sans musique. Après avoir assisté aux concerts de jazz dans tous les lieux alternatifs de New York, The Stone, The Knitting Factory, Roulette, the Vision Festival, Alain Kirili a ouvert son loft aux musiciens de l’avant-garde.
En 1998 il a fait un disque avec le jazzman afro-Américain Billy Bang, et il y a quinze jours il a organisé chez lui un concert benefit avec les meilleurs musiciens de la scène alternative pour aider Billy Bang, récemment opéré de la hanche, à payer ses factures médicales. Il suffisait d’être là, dans le loft de White Street plein de monde où se côtoyaient artistes et écrivains de Downtown assis par terre au pied des sculptures de Kirili, autour des musiciens afro-américains qui se livraient à d’extraordinaires improvisations, dont un dialogue avec le chien de la maison, Max, un Jack Russell de dix-sept ans, qui répondait au son du saxophone par une série de “ouaf!”, pour comprendre qu’Alain Kirili n’était plus tout à fait français et qu’il avait réalisé son rêve: celui d’un flux créatif à travers l’échange.
Alain Kirili, sculpteur
Par Catherine Cusset / Le 23 octobre 2007 / Culture
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER
![[Webinaire] La mobilité intelligente pour vos retours en France, avec Renault Eurodrive](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/01/webinaire-renault-eurodrive-fmus-2026-150x150.jpg)
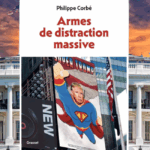


![[Vidéo] Salariés expatriés : comment négocier votre rupture de contrat de travail ?](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/12/webinaire-13-janvier-2026-avi-bitton-150x150.png)
