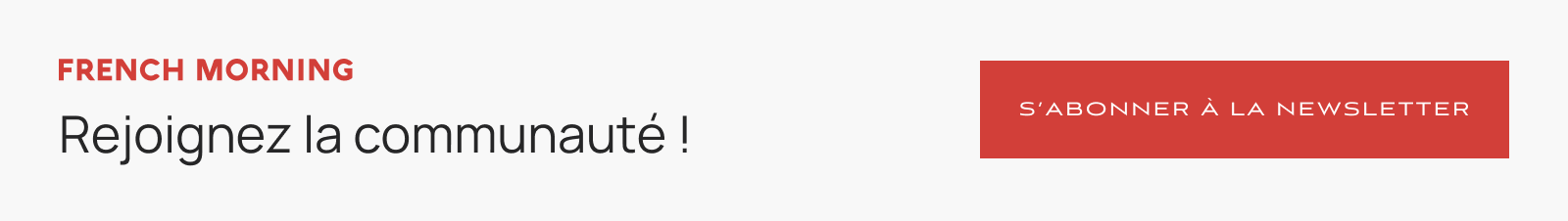Je n’avais jamais entendu parler d’elle. Je suis de loin, et souvent avec du retard, l’actualité littéraire. Mais à New York cet automne, il y avait autour du nom de Claire Messud ce qu’on appelle un “buzz”, ce bruit qui met soudain un écrivain sur le devant de la scène. “N’est-elle pas Française?” quelqu’un m’a demandé. “Je ne crois pas,” ai-je répondu. Je n’en avais aucune idée. Son nom, son roman, The Emperor’s Children, apparaissaient dans un journal ouvert au hasard, en devanture d’une librairie, dans le métro, sur la console de l’entrée chez des amis qui nous avaient invités à dîner. J’ai décidé d’emprunter le livre à la bibliothèque: j’étais sept cent troisième sur la liste d’attente. Ça ne me dérangeait pas. Puis un ami m’a dit: “Tu as lu Claire Messud? Elle est Française. Vous avez plein de choses en commun. Elle raconte son histoire dans son précédent livre, The Last Life. Il te plairait, je pense.” 
À Barnes and Noble, j’ai découvert qu’elle était l’auteur de quatre livres, When the World was Steady, The Hunters, the Last Life, and The Emperor’s Children. Tous ses livres précédents avaient été des “New York Times Notable Book of the Year,” mais elle n’avait guère eu de succès commercial jusque là. Elle était considérée comme un auteur “littéraire.” Deux de ses livres étaient traduits en français, chez Gallimard.
J’ai commencé The Last Life avec la circonspection qu’on a souvent quand on découvre un nouvel auteur, surtout quand l’auteur en question est à la une de l’actualité et qu’on est soi-même écrivain. The Last Life raconte deux années dans la vie d’une adolescente française vivant sur la côte d’Azur, dont la mère est américaine, et le père un pied-noir d’Algérie. Le père de Claire Messud est en effet un pied-noir d’Algérie, et sa mère américaine, mais j’ai été surprise de lire dans un entretien qu’elle a grandi en Australie et au Canada, pas en France. Je ne peux m’empêcher de penser qu’elle a des grands-parents sur la côte d’Azur, chez qui elle a passé les étés de son adolescence car il y a dans ce livre un ton autobiographique qui ne trompe pas.
L’adolescente retrouve chaque soir un groupe d’amis au bord de la piscine de l’hôtel de son grand-père, et c’est là que se passe le drame. Le grand-père déprimé et paranoïaque finit par tirer un soir sur les adolescents et par blesser l’une d’elle. Claire Messud remonte alors dans le temps pour narrer l’histoire de son grand-père en Algérie et celle de son père. Anglo-saxonne par son goût du détail réaliste très visuel, Messud est française par son penchant pour l’analyse et la réflexion philosophique. Plus on avance dans le livre et plus on se laisse prendre par l’histoire de cette famille de pieds-noirs d’Algérie et leur nostalgie du pays perdu. Messud sait fabriquer une histoire, “a story”. Il y a dans la voix de sa jeune narratrice, même quand elle raconte des événements aussi dramatiques que le suicide du père, un certain détachement, une froideur même, mais aussi une gravité et une beauté qui font qu’on n’a pas envie de quitter le livre mais qu’on souhaiterait s’enfoncer avec elle dans son passé et le désert algérien.
The Emperor’s Children est un livre complètement différent. C’est un roman à la 
troisième personne, plein de personnages, d’intrigues et de dialogues, sur de jeunes trentenaires new-yorkais pendant une année qui s’achève avec 9/11. Les deux premiers chapitres évoquent des lieux très contrastés: un dîner mondain en Australie où une jeune productrice new-yorkaise tombe sous le charme d’un journaliste à l’accent britannique qui doit bientôt venir s’installer à New York; une maison dans les Berkshires où une jeune new-yorkaise riche s’est retirée pour achever le livre qu’elle traîne comme un boulet depuis presque dix ans. L’extrême précision du détail et l’abondance du dialogue font surgir les lieux et les personnages. Quand j’ai commencé ce livre, j’ai pensé qu’il allait me tenir délicieusement compagnie. Petit à petit, j’ai déchanté. The Emperor’s Children est un roman très ambitieux, mais après un début brillant, il m’a paru s’essouffler, n’avoir pas les moyens de son ambition. Il n’y a pas un personnage qui s’élève au-dessus des autres. Ils sont tous médiocres et mesquins, même le tout jeune homme débarqué de sa province qui veut démasquer son oncle, le grand homme, le cynique écrivain à succès. Messud sait remarquablement décrire les petitesses de l’amour et de l’amitié, le regard critique qu’on porte sur le narcissisme insupportable de l’autre sans jamais le lui dire. Mais on aurait envie, parfois, de sentiments plus élevés. Visiblement, elle ne croit pas en ses personnages. Elle ne les aime pas. Leur médiocrité a quelque chose d’adolescent.
Juste après avoir fini The Emperor’s Children, je suis tombée sur plusieurs personnes qui venaient de le lire. Chaque fois j’ai entendu exprimer la même déception: “Ce n’est pas si bien, quand même. Je ne sais pas pourquoi on en a tant parlé.” Et pourtant, chacune de ces personnes l’avait lu en entier et avec plaisir: c’est un livre facile et vivant, qui se suce comme un bonbon.
J’ai lu un entretien où Claire Messud se demandait si elle devait attribuer son succès commercial au fait qu’écrivant ce livre entre deux tétées, elle l’avait dépouillé des réflexions dont ses autres livres étaient remplis. Ce serait une bonne nouvelle pour les romancières qui hésitent à procréer par peur de perdre leur créativité: faites des enfants, et vous écrirez des livres alertes, vifs et malins. Plus tristement, cela confirme que le récit disparaît aujourd’hui au profit du dialogue et du “power point.” Débarrassée de sa profondeur, Messud est devenue facile à lire. Il y a des arguments en faveur de la difficulté.
En tout état de cause, je n’ai pas eu envie de m’arrêter là. C’est à cela qu’on reconnaît un auteur: au désir que l’on a de lire ses autres livres. À peine ai-je commencé The Hunters, un livre qui rassemble deux courts romans, que j’ai embarqué. C’était du récit, pas du dialogue. La première histoire racontait la vie entière d’une Ukrainienne qui avait survécu à la seconde guerre mondiale dans des conditions terribles puis émigré aux États-Unis; la deuxième, l’été londonien d’un jeune universitaire hanté par une étrange voisine qui lui inspire de la répulsion. J’ai trouvé fascinants les deux portraits de femmes. Achevant la première histoire, j’ai eu l’impression nette qu’il s’agissait d’une parodie d’Un coeur simple de Flaubert, un de mes récits préférés, et me suis soudain aperçu que le titre de l’histoire était A Simple Tale. J’en ai conclu que la deuxième histoire aussi devait être un clin d’oeil ou une citation, mais ma culture insuffisante ne me permet pas d’en donner la source.
Malheureusement, il ne me reste plus qu’un livre de Claire Messud à lire. Il y a des auteurs dont on souhaiterait une plus grande productivité, car on n’a pas envie de les quitter. Si vous la croisez avec ses deux petits enfants dans les rues de l’Upper East Side, où l’on m’a dit qu’elle habitait, dites-lui de ma part de retourner vite à sa table de travail. Merci.
“Vous avez lu Claire Messud?”
Par FM / Le 16 mars 2007 / Culture
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER