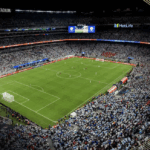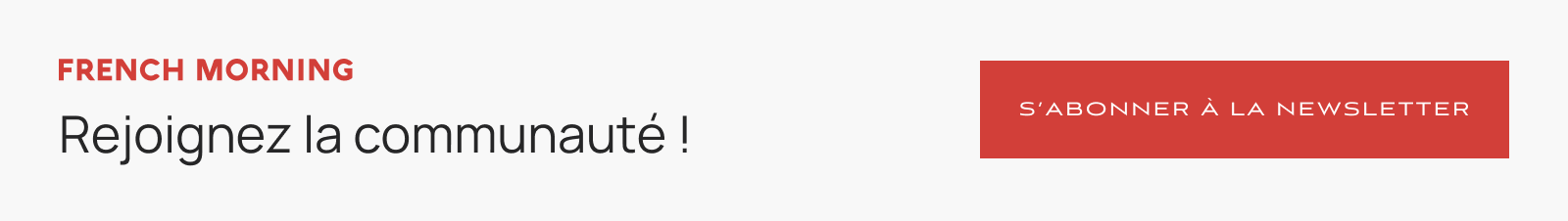« La France et les Etats-Unis ont eu l’air d’être les meilleurs amis dimanche », écrit le New York Times après la rencontre en France de la sécrétaire d’Etat Condoleezza Rice et du ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner sur la crise au Darfour. « Il n’y avait aucune trace des tensions qui ont marqué les relations du gouvernement Bush avec l’ancien président Jacques Chirac ».
L’éditorialiste Jim Hoagland est encore plus euphorique dans le Washington Post. « Le nouveau président de France est un ouragan d’air frais », écrit-il, « en cinq semaines, Nicolas Sarkozy a conçu un gouvernement comme aucun que les Français n’aient eu jusque là, en terme de diversité et d’ouverture politique. » C’est une équipe qui « va au-delà de tout ce qu’a déjà pu faire une administration américaine – sans parler des gouvernements français – en terme de diversité ethnique, sociale et politique, et d’audace». Avec Kouchner, Sarkozy et Jean-David Lévitte, l’ancien ambassadeur conseiller en affaires étrangères, « l’Histoire a présenté au gouvernement Bush un cadeau important qu’il ne devrait pas ignorer ».
Le Boston Globe consacre un éditorial à la séparation de Ségolène Royal et François Hollande. La phrase de Ségolène invitant son compagnon à quitter le domicile pour vivre son histoire sentimentale « a été décodée dans la presse française comme une allusion à la liaison de Hollande avec une journaliste de Paris Match, (…) qui a couvert les socialistes et écrit des portraits admiratifs du leader socialiste ». « Si c’était une pièce de Molière, les personnages parleraient en alexandrins, le public de la Comédie Française auraient des sourires amusés. Mais la farce jouée par Royal et Hollande n’est pas vraiment drôle pour leurs collègues et électeurs socialistes ».
Une campagne électorale ne fonctionne pas comme une comédie, rappelle le Boston Globe. « Hollande peut-il espérer être pris au sérieux quand, malgré le projet de Royal de le remplacer à la tête du parti socialiste, il insiste pour dire que leur séparation est purement une « affaire privée » et n’a pas de « causes ou conséquences politiques » ?».
L’éditorial du Boston Globe concède que « la vie privée d’un homme politique ne doit pas être considérée comme un indicateur de sa capacité à conduire des affaires d’état. Mais les électeurs n’aiment pas qu’on leur mente, que cela vienne des hommes politiques ou des journalistes qui les couvrent. Ni en Amérique, ni en France ».
Le Washington Post s’amuse de l’interdiction du BlackBerry dans les bâtiments du gouvernement au nom de la sécurité nationale. Même si, ce type de téléphone « est bien plus populaire dans les Etats-Unis accros au travail qu’en France – un pays dont les citoyens protègent farouchement leur courte semaine de travail et leurs longues vacances ».
Vie privée / vie publique en France et aux U.S.
Par Guillemette Faure / Le 30 juin 2007 / Politique
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER