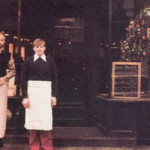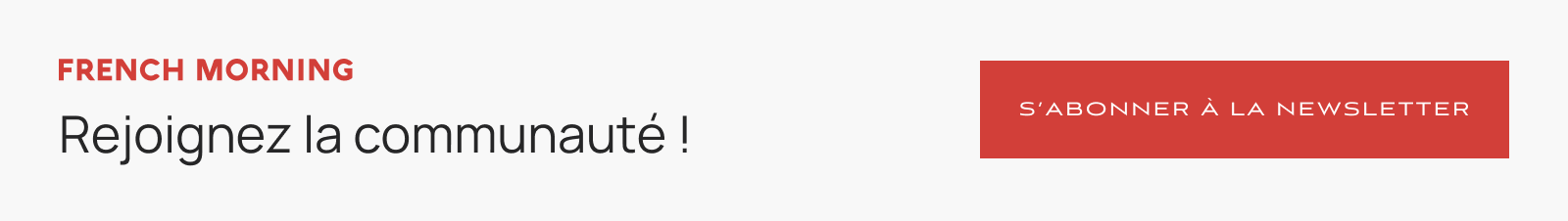S’installer dans la Grosse Pomme? Un rêve pour de nombreuses PME francophones! A première vue, New York a tout pour plaire à un entrepreneur venu d’Europe: peu de barrières administratives pour créer la structure de sa société, des charges salariales moins élevées, la possibilité de licencier plus facilement en cas d’erreur de casting,…
Seulement voilà, il y a un envers du décor. Et si aucune statistique n’existe, un consultant assure que “le taux d’échec est bien supérieur à 50%”. Car dès l’arrivée, l’entrepreneur mû par son American Dream découvre, en vrac, des brokers parfois malhonnêtes, des frais fixes et de démarrage élevés comme des loyers qui peuvent doubler ou tripler à la fin d’un bail, l’ouverture facilitée de procédures judiciaires et par-dessus tout, une mentalité assez différente de celle qu’on connaît en Europe. “S’implanter à New York demande du temps. Il faut en appréhender la mentalité, repenser son produit, son packaging, tisser un réseau fiable de distributeurs locaux, bien connaître ses concurrents, être accompagné d’un bon avocat,…”, prévient le consultant Franck Toussaint d’Intraco Consulting, une société qui accompagne des entreprises européennes lors de leur implantation en Amérique du Nord.
Trop ambitieuses
Dans le milieu des consultants spécialisés, on se souvient encore de l’échec cuisant, dans les années 1990, des Galeries Lafayette, qui en s’installant sur la prestigieuse 5ème avenue à côté des monstres sacrés Saks et Bergdof Goodman n’ont pas tenu le coup financièrement face au loyer exorbitant exigé par le maître des lieux Donald Trump. Le grand magasin a fermé en 1994 après avoir enregistré 3 années de pertes sèches.
Beaucoup plus récemment, le label de maillots de bain et de lingerie fine haut de gamme français Eres (groupe Chanel) a été contraint de réduire la voilure après avoir inauguré un flagshipstore sur Madison Avenue ainsi qu’une autre boutique à SoHo. Deux points de vente fermés à la fin des années 2000, n’ayant pas atteint la rentabilité espérée en termes d’exploitation. La marque est désormais vendue uniquement chez Barney’s à New York. Pour Olivier Mauny, Directeur Général du label, ouvrir des magasins en mains propres à Manhattan n’était pas “une formule gagnante”. “Il y a un an et demi, nous avons décidé de revoir complètement notre stratégie de développement aux Etats-Unis en misant plutôt sur des franchises et des corners dans des magasins multimarques, une approche moins risquée au niveau financier”, commente-t-il. Une nouvelle franchise a ouvert ses portes en 2011 à East Hamptons et le label est aussi présent à Shelter Island, deux endroits plus stratégiques pour la vente de pièces balnéaires. “Nous avons aussi des magasins franchisés à Beverly Hills, Miami ainsi qu’à Las Vegas depuis avril 2012 et nous continuons notre développement dans le reste du pays, en pensant notamment à Chicago, San Francisco et Hawai”, ajoute Olivier Mauny.
Fauchon fauché
Même revirement de stratégie pour l’épicerie fine parisienne Fauchon dont les trois boutiques new-yorkaises ouvertes coup sur coup au milieu des années 2000 ont été fermées par le nouveau propriétaire de l’époque Michel Ducros, plus intéressé par la conquête de l’Asie, de la Russie ou du Moyen-Orient. Il se murmure aussi que l’entreprise, fortement endettée, aurait vu trop grand à New York et aurait été obligée de fermer ses magasins en mains propres suite à de lourdes difficultés financières. Autre erreur invoquée: une structure peu adaptée au marché américain et des ouvertures de boutiques un peu trop précipitées. En 2009, Fauchon est pourtant reparti à l’attaque du marché américain en changeant de tactique: pas de flagshipstore, véritable gouffre financier, mais une distribution dans les gourmets stores du pays gérée par Patrick Charpentier, via sa société Taste of Paris implantée à Miami. Une tactique certes moins risquée, mais condamne aussi toute ambition de conquête.
Trop modestes
Si certaines boîtes ont vu trop grand, d’autres sont allées droit dans le mur car elles se sont montrées, à l’opposé, trop prudentes dans leur aventure à l’export. C’est le cas de l’entreprise belge Les Tartes de Françoise. En 2010, forte de son succès en Belgique, cette entreprise familiale de production de quiches et de cheesecakes décide de s’implanter à New York en collaboration avec Dimitri Van Meerbeeck. A peine deux ans plus tard, l’atelier met la clef sous le paillasson. Il semblerait que, dès le début, la PME n’ait pas adopté la bonne stratégie. En voulant débuter petit en limitant au maximum les investissements, l’atelier de production (sans vitrine) était trop discret et situé dans un endroit reculé de Hell’s Kitchen. Le loyer était certes peu élevé mais les clients ne pouvaient trouver l’endroit…
Olivier Laffut, directeur de la PME, interrogé récemment par le magazine économique belge Trends-Tendances avoue les raisons de cet échec : “On aurait dû étudier beaucoup plus le marché professionnel, aller davantage à la rencontre du client pour mieux connaître ses besoins et ses souhaits avant de croire que le produit qui fait notre succès en Belgique allait d’emblée séduire les professionnels new-yorkais”. Dimitri Van Meerbeeck ajoute: “Il fallait pouvoir s’adapter rapidement aux goûts des Américains, en ajustant les portions et en adaptant certaines recettes, tout en restant fidèle à notre produit de base”. Il mentionne une autre lacune importante: “Quand j’ai quitté la gestion de la PME à l’été 2011 (ndlr : quelques mois avant la fermeture définitive) l’atelier a été géré de la Belgique. Selon moi, il faut toujours avoir une personne du management sur place pour veiller au grain” et émet un dernier conseil : “A New York, il ne faut jamais relâcher la pression, toujours rester vigilant et être prêt à assumer les coûts financiers pendant une période de 1 à 2 ans”.
« Tout recommencer à zéro »
Une chose est certaine, réussir dans son pays ne garantit pas le succès outre-Atlantique et croire qu’afficher la French (ou Belgian) touch suffira à conquérir les New-Yorkais est bien idéaliste. Une réflexion approfondie en amont est indispensable pour s’adapter, certains experts avancent qu’il faut parfois même quasiment tout recommencer à zéro. Franck Toussaint relève une autre erreur: “Je remarque que certains dirigeants d’entreprise ne sont pas toujours à l’écoute de leurs partenaires locaux et n’arrivent pas à s’adapter à leur fonctionnement, une attitude obstinée qui peut conduire à leur perte.” Jerome Bouston, consultant au sein d’Altios International basé à New York, souligne l’importance d’être bien accompagné dans toutes les étapes de l’exportation et surtout de se différencier sur un marché fortement concurrentiel. “En tant qu’étranger, pour réussir à New York, il faut proposer un produit innovant, à forte valeur ajoutée, c’est la raison pour laquelle, les gaufres du Flamand Wafels and Dinges cartonnent. Parfois, la simple appellation du produit peut aussi lui être fatale, le nom Blédina, par exemple, n’a jamais réussi à percer aux USA. Il ne faut donc pas avoir peur de “s’américaniser””.
Jerome Bouston, ajoute qu’en temps économiques incertains, la prudence est plus que jamais de mise dans cette aventure à l’export. “En général, de petites marques tiennent plus facilement le coup quand elles sont soutenues dans leur développement à l’international par de grands groupes de luxe”, explique-t-il. Il conclut toutefois sur une note positive: “Ce n’est pas parce qu’une PME a vécu une première expérience décevante qu’elle doit faire une croix à jamais sur New York, elle pourra revenir plus tard en ayant mieux analysé le marché et ses besoins”. Voilà qui devrait peut-être rassurer certains entrepreneurs dans la réalisation de leur rêve américain.