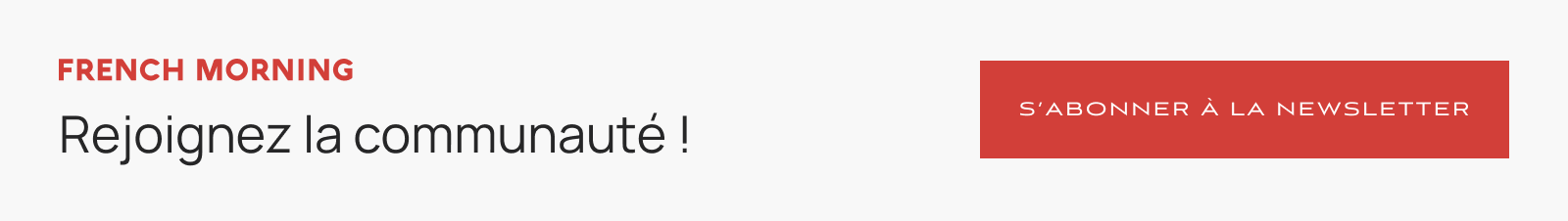Cela fait quatre mois que je suis rentré en France après trois années en Amérique du Nord. J’ai passé la moitié de ce temps à New York, à arpenter les rues avec ma valise à roulettes pleine de bouteilles de vin en tant que représentant d’un grand négociant français. Maintenant je suis à Paris, chez moi, et paradoxalement, je souffre depuis mon retour d’un étrange mal du pays.
C’est un article du Monde paru récemment qui a diagnostiqué mon mal-être et mis un mot dessus : l’impatriation. Cela m’a fait du bien de lire les témoignages de Français rentrés au bercail après avoir vécu plus ou moins longtemps sous d’autres latitudes et, égoïstement, j’ai été rassuré de comprendre que je ne souffrais pas d’une maladie orpheline.
L’article décrit très bien la difficulté de réadaptation à son milieu d’origine et l’état dépressif qui peut l’accompagner. Un des premiers obstacles rencontrés par les impatriés est l’absence d’accueil au retour et l’incompréhension des services de l’État. C’est un point que j’ai trouvé très pertinent, ayant moi-même l’impression de ne “rentrer dans aucune case” de la machine administrative. Pourtant, c’est aussi pour cela que je suis rentré : la Sécurité Sociale, l’éducation gratuite de qualité pour les enfants… Alors je me dis que je devrais éviter de voir tout en noir et blanc et idéaliser les États-Unis au détriment de la France. Mais malgré tous les bons côtés de mon pays, je ne peux lutter contre la nostalgie et tirer une croix sur New York.
A mon retour, je n’avais pas mesuré le changement qui s’était produit en moi pendant cette parenthèse. Je n’étais plus le même et j’avais perdu mes points de repères au profit de la norme américaine. Le décalage s’est manifesté d’abord par des détails comme le volume des briques de lait qui passe du gallon au litre ou bien celui des voitures dans la rue qui semblaient avoir été rétrécies comme par magie. C’est peut-être pour cela que je me suis senti immédiatement à l’étroit dans cette ville où j’avais pourtant passé toute ma vie.
En France, mes rapports aux gens sont changés par mon expérience d’expatriation, aussi courte fût-elle. Ici, j’essaye de reformer un cercle d’amis et je me sens beaucoup plus compris par ceux qui ont passé du temps à l’étranger. Ceux qui sont restés ne réalisent pas vraiment ce que j’ai vécu et pensent souvent que si je suis rentré c’est que j’ai échoué. Beaucoup de ces mêmes personnes parlent de partir sans n’avoir jamais franchi le pas et continueront leur vie malheureuse à se plaindre de leur enfer parisien sans jamais prendre le large. J’ai l’impression de voir en eux ces vieux couples qui s’engueulent à longueur de journée mais qui ne se sépareront jamais.
Mais maintenant que je suis rentré, qu’est ce qui me distingue de ces gens-là finalement? Je ne suis plus “l’oncle d’Amérique”, je suis plus le type en visite à Paris, sur le point de repartir à New York. Mon égo a, du coup, subit un revers parce que c’est vrai que j’aimais bien mon statut exceptionnel lors de mes visites en France.
Depuis mon retour, je suis passé d’expatrié à impatrié mais je ne le resterai pas éternellement. Donc soit je redeviens un citoyen comme les autres, soit je fais à nouveau mes valises et retrouve mon statut d’expatrié. Mais pour l’instant à part une inscription à la loterie de la Green Card et un cierge brûlé à Notre-Dame, j’ai n’ai pas fait grand-chose de concret pour me réinstaller de l’autre côté de l’océan. Alors, en attendant que le Ciel ou les services d’immigration américains se manifestent, je me dis que je devrais peut-être profiter de la nouvelle année pour prendre quelques bonnes résolutions : arrêter de saouler mon entourage en parlant de New York à longueur de journée, ne plus visionner en boucle des films qui se passent là-bas, et mettre de côté l’idée de que je vais revenir m’y installer tout de suite. Bref, prendre du recul, parce que finalement, le blues de l’impatriation est un sentiment tellement proche de la rupture sentimentale que je me demande parfois si je ne suis pas tombé amoureux de New York.
En fin de compte, “impatrié”, “expatrié”, “apatrié”, je ne sais plus trop ce que je suis et les jours où mon esprit cartésien si français l’emporte sur mon optimisme américain, je me dis que la raison voudrait que je tourne la page new-yorkaise, pour reconstruire ma vie en France. Mais ça se saurait, depuis le temps, si l’amour était raisonnable.



![[Webinaire] Patrimoine et fiscalité au moment du retour en France](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/06/v2-Webinaire-USAFrance-aout-2025-150x150.png)