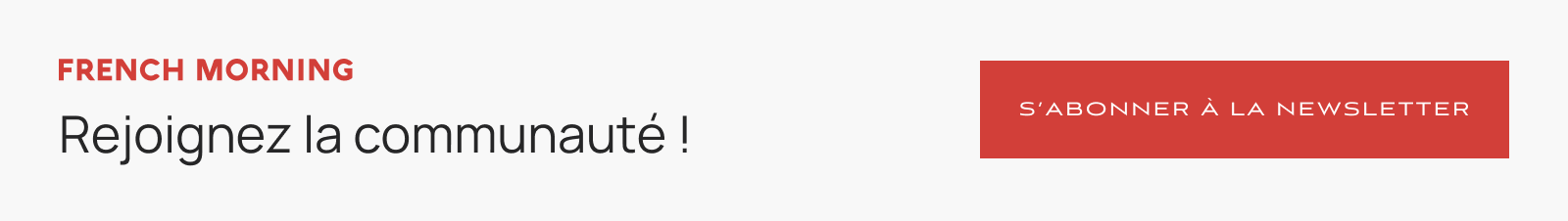Comme des millions de personnes, j’ai profité des Fêtes pour aller voir “Les Misérables”, le film adapté de la comédie musicale à succès.
J’étais plutôt bien disposé. N’ayant pas vu le “musical”, je n’avais aucune exigence. Collégien, j’avais lu (une partie) du chef d’œuvre de Victor Hugo. Le casting du film avait de quoi faire saliver: Hugh Jackman dans le rôle de Jean Valjean, Russel Crowe en Javert et la sublissime Anne Hathaway en Fantine, mère de Cosette (Amanda Seyfried). L’histoire est puissante, universelle et atemporelle. Petit rappel: Jean Valjean, un ex-bagnard en quête de rédemption sauve une jeune orpheline, Cosette, du destin misérable qui lui est promis. Valjean est poursuivi sans relâche par l’inspecteur de police Javert, qui veut le remettre en prison pour avoir rompu sa liberté conditionnelle il y a des années de cela. Valjean et Cosette vivent dans la fuite et l’anonymat, sur fond de société au bord de la révolution, jusqu’au jour où la belle rencontre Marius, un jeune révolutionnaire.
“Mais qu’ils arrêtent de chanter!”
Bien disposé donc. Mais cela n’a duré que dix minutes. Car cette histoire, le réalisateur Tom Hooper la transforme en soupe tiédasse. Pendant tout le film, on a envie de dire aux personnages… d’arrêter de chanter. Les chansons ne sont pas en cause. Elles sont belles pour la plupart, mais leur omniprésence est pesante: les acteurs chantent tout – TOUT – le temps. Et mal pour certains. Les bonnes performances vocales de Hugh Jackman (qui s’est produit sur Broadway) et d’Anne Hathaway ne compensent pas le reste. Russel Crowe, qui n’articule déjà pas en temps normal, ne convaincrait même pas ses enfants. Comment prendre au sérieux un inspecteur de police à la voix de crooner? Malheureusement, c’est par l’une de ses chansons que s’ouvre le film. Pas sympa!
Le film, qui fait 2h30 – et on les sent passer – pourrait libérer les spectateurs quelques minutes plus tôt si certaines chansons d’Eponine, l’amoureuse de Marius, et de Marius lui-même, l’amoureux de Cosette, ne trainaient pas en longueur. Remarquez: si les chansons étaient servies par des interprétations magistrales (comme celle d’Anne Hathaway pour “I dreamed alone”, qui marque la descente aux enfers de son personnage), peut-être le temps passerait-il plus rapidement.
Il y a aussi beaucoup à redire sur la performance des acteurs. Helena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen, cautions comiques des « Miz » dans le rôle des diaboliques Thénardier, se sont trompés de film: ils sont les copies conformes de leurs personnages dans “Sweeney Todd”, le film de Tim Burton lui aussi adapté d’une comédie musicale. Ils peinent donc à s’effacer devant leur personnage. Passons également sur le maquillage et l’épilation des sourcils d’Eponine. On lui aurait mis un i-Pod entre les mains, cela n’aurait pas choqué. Enfin, Hooper nous achève avec son parti-pris assumé de faire du gros-plan à tout va. Le spectateur a l’impression d’être coincé dans une petite pièce avec les acteurs.
Vive le playback
Tom Hooper était conscient de la difficulté de l’exercice. Adapter au cinéma un « hit musical » vieux de plus de trente ans n’est pas mince affaire. Il l’a dit lui-même dans une interview au Christian Science Monitor: « J’étais conscient que des millions de personnes portent les Misérables près de leur cœur et seraient probablement assis, complètement effrayés, au cinéma ». Il ne s’est pas facilité la tâche en demandant à des acteurs pour la plupart novices en chant de pousser la chansonnette « en direct », au lieu de recourir au traditionnel playback, comme ce fut le cas pour d’autres comédies musicales adaptées au grand écran.
On aurait préféré que Hooper prenne le parti plus audacieux d’adapter au grand écran le livre d’Hugo plutôt que la comédie musicale, un style qui se nourrit nécessairement de personnages caricaturaux et d’une histoire simplifiée et édulcorée. Eut-il choisi d’en faire un film “traditionnel”, Hooper, auquel on doit le magistral “The King’s Speech”, aurait sans doute produit des personnages plus denses et complexes, des dialogues travaillés et exigeants. Malheureusement, en choisissant une forme de facilité, il tombe dans un entre-deux faiblard.
Qu’il se rassure, le film sera un succès. Il a réalisé près de 40 millions de dollars au box-office dans les trois premiers jours après sa sortie. Les critiques voient dans Jean Valjean un modèle de reconversion pour les ex-détenus, et le réalisateur répète à l’envi que le film fait écho à notre époque tourmentée pour faire croire qu’il n’est pas qu’une simple bête de box-office. Il n’est pas autre chose.


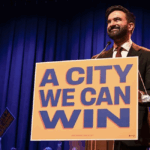
![[Webinaire] Patrimoine et fiscalité au moment du retour en France](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/06/v2-Webinaire-USAFrance-aout-2025-150x150.png)