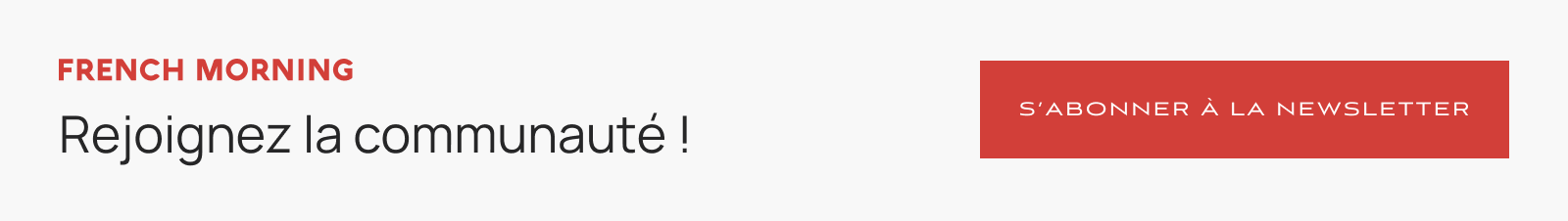Pour un Français, les élections américaines peuvent paraître déconcertantes. Comment expliquer qu’en 2024, Donald Trump pourrait être élu avec moins de voix que Kamala Harris ? Pourquoi le droit à l’avortement occupe-t-il une place centrale dans ces élections alors qu’une large majorité d’Américains y est favorable depuis longtemps ? Et pourquoi aucune loi fédérale sur l’immigration n’a pu être adoptée depuis près de trente ans alors qu’il s’agit d’un sujet majeur à chaque élection ?
Il faut revenir aux origines de la Constitution des États-Unis pour comprendre. Rédigée en 1787, soit deux ans avant la prise de la Bastille, par un groupe de délégués des 13 États nouvellement indépendants, elle est le fruit de compromis difficiles. Ces compromis, toujours en vigueur près de 250 ans plus tard, peuvent paraître étranges aux observateurs contemporains. Pourquoi George W. Bush en 2000 et Donald J. Trump en 2016 ont-ils été élus malgré un déficit de voix respectivement de 500 000 et de près de trois millions par rapport à leurs adversaires ?
La plupart des Américains vous diront que la Constitution prévoit une élection indirecte via des grands électeurs désignés État par État. Mais si vous leur demandez l’origine de ce système unique, absent des autres grandes démocraties, les réponses deviennent plus floues. Certains évoquent la protection des petits États; d’autres mentionnent la défense de la République contre le populisme, via l’élection de représentants supposés plus « sages » que le peuple peu éduqué du XVIIIe siècle.
Un système hérité de 1787 à l’avantage du candidat républicain aujourd’hui
La réalité est bien différente, mais elle est aujourd’hui enfouie, car jugée honteuse. L’origine de ce mode d’élection indirecte remonte à l’esclavage, en vigueur dans tous les États en 1787. Si les délégués s’accordaient sur le fait que seuls les hommes blancs pourraient voter, les États du Sud, où vivaient d’importantes populations d’esclaves, souhaitaient que ces populations, bien que privées du droit de vote, soient néanmoins comptabilisées pour renforcer leur poids électoral face aux États du Nord.
Aucun système d’élection directe n’aurait permis de donner plus de poids aux hommes blancs du Sud qu’à ceux du Nord. Les délégués de Philadelphie ont donc innové en concevant un système d’élection indirecte, reposant sur des grands électeurs. Chaque État obtenait ainsi un nombre de grands électeurs proportionnel à sa population blanche, augmentée de 60% du nombre d’esclaves. C’est le fameux « compromis des trois cinquièmes », qui a permis aux États du Sud de renforcer leur influence grâce aux esclaves, sans leur accorder le droit de vote. Mathématiquement élégant, mais indéfendable aujourd’hui.
Certes, l’abolition de l’esclavage en 1865 et les lois sur les droits civiques de 1965 ont fait disparaître toute justification de ce système complexe, conçu pour les mœurs du XVIIIe siècle. Cependant, aucun amendement n’a réformé le mode d’élection prévu par l’Article II de la Constitution des États-Unis. Aujourd’hui, avec des électeurs démocrates concentrés dans quelques grands États comme la Californie et New York, le système hérité de 1787, issu de l’esclavage, pourrait permettre au candidat républicain de 2024 de remporter plus de grands électeurs avec moins de voix. C’est ainsi que les élections du 5 novembre restent si incertaines et dépendent des seuls « swing states ».
L’absence de loi fédérale sur l’avortement
Venons-en à l’avortement. Tous les États européens ont adopté des lois sur l’avortement par voie parlementaire, comme l’a fait l’Assemblée nationale en 1974 en France. Aux États-Unis, en revanche, jamais le Congrès n’a légiféré sur cette question. C’est la Cour suprême qui a légalisé l’avortement en 1973 avec l’arrêt Roe v. Wade, avant de revenir sur cette décision en 2022, plaçant ce sujet au cœur des élections de 2024. Pourtant, près des deux tiers des Américains soutiennent le droit à l’avortement. Pourquoi le Congrès n’a-t-il jamais adopté de loi sur ce sujet, contrairement à toutes les autres grandes démocraties ?
Là encore, il faut se replacer en 1787. En dehors de la démocratie athénienne de Périclès et de la République romaine de Cicéron, les délégués réunis à Philadelphie disposaient de peu d’exemples de démocraties fonctionnelles pour guider la fondation de leur jeune république. Craignant le retour d’une dictature et soucieux de préserver les prérogatives des États face au gouvernement fédéral, les 13 États fondateurs ont mis en place un système d’une complexité extrême où chaque institution est contrôlée par les autres : le célèbre principe des « checks and balances ».
L’un des aspects les plus surprenants de ce système est le processus d’adoption des lois. Pour qu’une loi fédérale soit approuvée, il faut l’accord complet de trois institutions indépendantes les unes des autres : la Chambre des représentants, le Sénat et le Président. Aucune démocratie européenne n’impose un tel mécanisme, souvent source de blocages. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes a le dernier mot sur la Chambre des lords et peut renverser le Premier ministre. En Allemagne, le Bundestag prime sur le Bundesrat et peut destituer le Chancelier. En France, la Constitution de 1958 suit une logique similaire : l’Assemblée nationale a le dernier mot sur le Sénat et peut renverser le Gouvernement. Le Président de la République, quant à lui, n’a pas le pouvoir de bloquer une loi. À l’exception de l’Italie, qui exige un vote conforme des deux chambres, toutes les démocraties en Europe donnent le dernier mot à l’une de leurs institutions.
Ces systèmes, rédigés bien plus récemment que la Constitution des États-Unis, ont bénéficié des expériences démocratiques modernes et présentent l’avantage de l’efficacité : lorsqu’une majorité change, une loi cruciale peut être adoptée à la majorité simple d’une seule institution.
Ce fut le cas en France avec la légalisation de l’avortement en 1974 ou l’abolition de la peine de mort en 1981, malgré les passions que ces débats suscitaient à l’époque.
Rien de tel n’est possible dans le système fédéral américain. Sur des questions de société aussi sensibles que l’avortement, la peine de mort ou le mariage homosexuel, aucun texte n’a jamais pu être adopté par le Congrès. C’est donc la Cour suprême qui intervient, en l’absence de législation, au terme de longues procédures judiciaires. Cela explique aussi le rôle éminemment politique de la Cour suprême aux États-Unis.
L’Union européenne « aussi complexe » que le système des « checks and balances » américain
En réalité, il existe en Europe un système tout aussi complexe que celui de la Constitution des États-Unis : l’Union européenne. Soucieux de préserver leurs prérogatives nationales, les États membres ont mis en place des traités qui exigent que les textes européens soient adoptés par l’accord conjoint de trois institutions indépendantes l’une de l’autre : le Conseil (qui regroupe les États membres), le Parlement européen et la Commission européenne.
J’ai eu l’occasion de pratiquer ce système pendant cinq ans à Bruxelles. Je me souviens d’un dîner avec Jean-Luc Lagardère, le fondateur de Matra, qui, avec un certain mépris, avait lancé : « L’Europe, c’est le règne des maquignons, tout se marchande. » J’avais trouvé cette formule
excellente et révélatrice d’un système où l’adoption de textes nécessite des compromis de toutes sortes pour obtenir l’accord des trois institutions. L’un de mes premiers chefs à la Commission, un vétéran des négociations communautaires, m’avait même confié son secret pour parvenir à un accord : « Il faut rendre les choses très compliquées. À un moment, plus personne n’y comprend rien, et les textes sont adoptés. »
Les Américains se plaignent, à juste titre, de l’incapacité de Washington à prendre des décisions. Ils méprisent leurs élus et détestent ce « marécage » que Trump promettait d’assainir en 2016 avec son célèbre « Drain the swamp! ». Ils reprochent au système son incapacité à adopter des lois de bon sens sur des sujets cruciaux comme l’immigration, les armes à feu ou l’avortement. L’une des causes réside dans la mécanique même de la Constitution des États-Unis, qui impose l’accord de trois institutions pour chaque loi, menant à des compromis souvent illisibles, à des marchandages peu glorieux et, bien souvent, à l’immobilisme.
Attention, ne dites jamais à des Américains que leur Constitution est perfectible. Pour eux, elle est parfaite. Elle est sacrée. Leur méfiance vis-à-vis de leurs élus n’a d’égal que leur vénération pour leur texte fondateur, dont le génie initial a permis deux siècles et demi de stabilité politique, de croissance économique, d’innovation technologique et de succès militaires. Cette tension est fascinante — et elle n’est pas près de disparaître.
Chaque semaine, French Morning publie la tribune d’une personnalité, extérieure à la rédaction, sur des sujets transatlantiques variés, afin d’alimenter le débat d’idées. Si vous souhaitez contribuer et proposer un texte (600 à 1200 mots), merci de nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]




![[Vidéo] Andorre : Un paradis fiscal ?](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/05/webinaire-17-juin-2025-150x150.png)