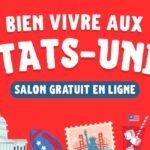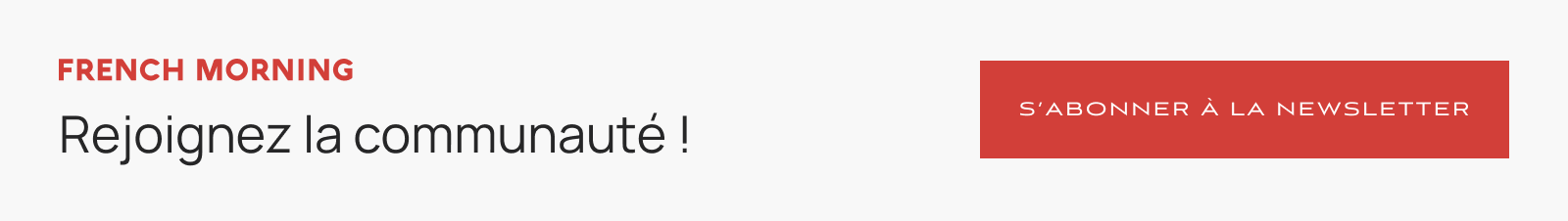La semaine dernière, il y a eu de la campagne française plein la presse américaine. A commencer par le Washington Post qui remarque que Ségolène n’a pas les femmes dans sa poche. Le quotidien a interrogé une femme ordinaire (elle avait un sac de courses à la main), qui « comme beaucoup de françaises » a suivi la campagne de Royal en espérant « un triumvirat de femmes à la tête de trois puissances occidentales pivots : Royal en France, Hillary Rodham Clinton aux Etats-Unis et Angela Merkel en Allemagne. » Mais à cinq semaines des élections, écrit le Post, les électrices lasses du pouvoir masculin comptent pourtant parmi les critiques les plus farouches de Ségolène. Est-ce que la France met la barre plus haut en termes de compétences parce que c’est une femme ? La France politique est-elle machiste ? « La France se classe 22ème des pays de l’Union européenne selon le pourcentage de femmes au parlement (avec un peu plus de 12 %), et en 87ème place mondiale, derrière le Pakistan, l’Afghanistan et les Emirats arabes, où le pourcentage de femmes au parlement est près du double de celui de la France ». Le Washington Post note encore que Ségolène joue de son image de femme et de mère, «à la différence de Merkel en Allemagne qui a gommé sa féminité au point de refuser d’embrasser des bébés en campagne ». Serrons les mains des bébés !
La correspondante du Christian Science Monitor a regardé Ségolène dans «A vous de juger » sur France 2, et note que la France s’est mise au format « town hall » (historiquement, les réunions à la mairie où chacun peut prendre la parole) avec des émissions « dans lesquelles des « vrais gens » plutôt que des journalistes ou des experts interrogent les candidats aux présidentielles ». Autrefois, le grand événement des campagnes françaises, c’était le débat, « la tendance cette fois est à des campagnes virtuelles qui court-circuitent journalistes et experts ». Ces émissions changent la nature du débat, puisque les gens comme tout le monde « ont tendance à utiliser leur minute d’antenne pour se plaindre du montant de leur retraite plutôt que pour titiller les hommes politiques sur la dette nationale ». Le format avait l’air d’arranger Ségolène. «C’est la démocratie participative, s’est enthousiasmée Madame Royal, adepte des manœuvres de contournement des questions du public et balayant les appels de l’animateur à des réponses concises ». La journaliste Susan Sachs relève que Sarkozy a répondu à 46 questions pendant l’émission, contre 27 pour Bayrou, « un ancien enseignant qui a tendance à faire la leçon ». (Les lecteurs noteront que pour le Christian Science Monitor, Bayrou est « un ancien enseignant » quand pour le New York Times, il est quasi systématiquement « un agriculteur »).
Les électeurs français se tournent vers Bayrou, parce qu’ils ont peur du discours dur de Sarkozy en matière d’immigration et de sécurité et sont inquiets des gaffes de Royal, selon le Washington Post. « Il attire les électeurs moins pour ses positions politiques, souvent mollassonnes, que pour son image d’homme politique honnête et droit».
Enfin, voilà Jean-Marie Le Pen sur les bulletins, « le politicien anti-immigration qui a surprise la France et le monde en finissant deuxième des présidentielles de 2002 » rappelle le Washington Post. « Bien qu’il ait été un loup solitaire dans la campagne de 2002 à dénoncer l’immigration et à épouser des politiques protectionnistes, beaucoup de ses vues font maintenant partie du débat politique » depuis l’embrasement des banlieues de l’automne 2005
Quant au New York Times, la campagne est le prétexte d’un article au vitriol sur l’état de la culture en France. « Le gouvernement français dépense 3,8 milliards en arts chaque année, trente fois le budget du National Endowment pour les Arts américains (…) Pourtant le mot culture a à peine été mentionné dans la campagne ». Alan Riding, correspondant à Paris a l’impression que « même les célébrités du showbiz ne sont pas courtisées par les candidats » (aie, Johnny va se désabonner de French Morning). Il a trouvé des gens qui se souciaient de cette absence : la réalisatrice Pascale Ferran dans son discours aux Cesars, la Soprano Natalie Dessay aux Victoires de la musique classique, et même le ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres. Les intellectuels français « qui ont pour habitude de se faire entendre sur les questions nationales et internationales semblent, disons si ce n’est pas silencieux, certainement confus, et dans la plupart des cas, gardent leurs distances des trois candidats ». « Est-ce important ? » se demande le correspondant Alan Riding. « Problablement pas. »
Certes « depuis 25 ans, les investissements du gouvernement français ont permis l’Opera Bastille, la pyramide du Louvre, la très grande bibliothèque, la Cité de la musique et récemment le Musée du Quai Branly », sans compter les subventions aux créateurs et artistes en tout genre. « Est-ce que les contribuables français en ont pour leur argent ? » demande Alan Riding. Il a l’air de penser que non. « La scène artistique française a perdu de son écho. La culture du passé semble à l’abri, avec des musées publics, des opéras et des théâtres bien fréquentés. Mais les créateurs, des artistes visuels aux écrivains, semblent déconnectés de la société. Dans un pays saisi d’incertitude sur son identité, dans une campagne dominée par les changements du monde (ah oui ?), ils n’ont pas grand-chose à dire. »
Il voit une explication : « les artistes, comme beaucoup de gens en France, sont obsédés par la protection de leurs privilèges ». Et « quand les Français se plaignent de la morosité de l’état de l’art contemporain, ils blâment instinctivement le gouvernement, comme si les artistes et galeries ne portaient aucune responsabilité ». Bon, on a un peu perdu la campagne en cours de route mais Alan Riding a vidé son sac dans un article qui évoque un peu son « Où est passé la gloire de la France ? » qui avait fait des remous il y a dix ans.
Malheureusement, à cette époque, vous n’aviez pas ni revue de presse, ni French Morning.
La presse américaine se passionne pour la campagne française
Par Guillemette Faure / Le 20 mars 2007 / Politique
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER