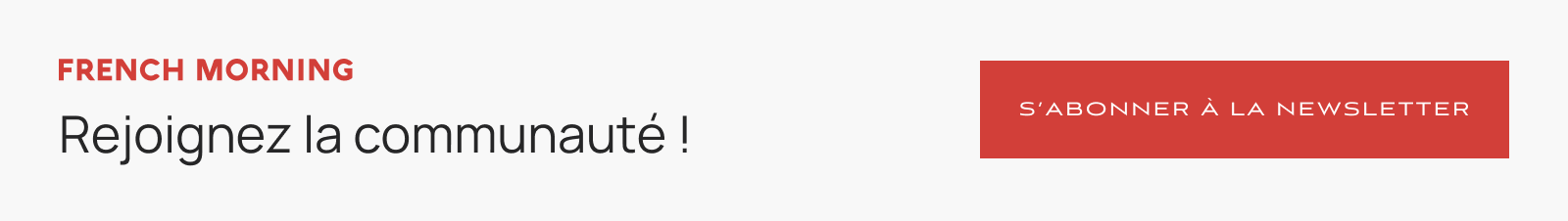Vous cherchez un livre pour l’été. Vous pourriez acheter le dernier Carrère dont tout le monde parle à Paris ou, mieux, le second roman malin d’une jeune romancière, Muriel Barbery, ancienne khâgneuse qui place son érudition dans la bouche d’une concierge (L’élégance du hérisson, Gallimard, 2007). Je vous propose autre chose.
Loin de Paris, loin de New York, loin de toute actualité—mais y a-t-il d’actualité plus brûlante?—un livre paru en 2001 qui n’est ni un roman de gare, ni un roman de plage, et qui va vous transporter très loin.

C’est la dernière oeuvre d’un Allemand, Winfried Georg Sebald, né en Bavière en 1944 et mort en 2001. Le titre: Austerlitz. Ce livre vous demande un effort. Pourquoi pas? De par mon éducation judéo-chrétienne, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas de gratification sans épreuve.
La phrase de Sebald, longue et parfaitement polie, vous fait entrer dans un rythme plus calme, plus lent: celui de la pensée.
Ainsi s’ouvre le livre: “Dans la seconde moitié des années soixante, pour des raisons tenant en partie à mes recherches et en partie à des motivations que moi-même je ne saisis pas très bien, je me suis rendu à plusieurs reprises d’Angleterre en Belgique, parfois pour un jour ou deux seulement, parfois pour plusieurs semaines.” Le balancement symétrique de la phrase montre un esprit circonspect, qui examine sans courir à la conclusion. Le narrateur de Sebald prend son temps. Il commence par nous décrire en long et en large la gare d’Anvers, puis le Nocturama du jardin zoologique—fournissant à l’appui des photos d’yeux de chouettes, car le livre s’accompagne de photos. C’est à la gare d’Anvers que le narrateur rencontre par hasard un certain Austerlitz avec qui il a une conversation sur l’architecture. “Austerlitz parla longuement des traces que laissent les douleurs passées, et qui se manifestent, prétendait-il savoir, sous la forme d’innombrables lignes ténues sillonnant l’histoire. Étudiant l’architecture des gares, (…) il ne pouvait s’empêcher de penser, bien que cela n’ait rien à voir avec le sujet, au tourment des adieux et à la peur de l’inconnu.”
De rencontre de hasard en rencontre de hasard, à Liège, puis à Bruxelles, on n’en sait pas plus. La conversation des deux hommes porte exclusivement sur l’architecture, car “avec lui il était pratiquement impossible de parler de soi-même (…) et par conséquent on ne savait pas d’où l’autre venait.” Ayant finalement appris qu’Austerlitz travaillait non loin du British Museum à Londres, le narrateur, qui vit lui aussi en Angleterre, lui rend visite régulièrement au cours des années. Austerlitz lui parle de ses travaux sur l’architecture de l’ère capitaliste, et, en particulier, de sa fascination des réseaux et des gares. À la suite d’un séjour du narrateur en Allemagne et d’une lettre restée sans réponse, ils se perdent de vue. Nous sommes à la page 51 du livre: il ne s’est toujours rien passé.
Vingt ans plus tard, en décembre 96, alors que Sebald est allé voir un oculiste à Londres et attend son train au salon bar du Great Eastern Hotel pour retourner à Norwich, une silhouette le frappe parmi la foule des hommes d’affaires. Il reconnaît aussitôt Austerlitz, dont il s’avise qu’avec son sac à dos et son expression d’effroi, il ressemble à Ludwig Wittgenstein. “Austerlitz, sans perdre le moindre mot sur notre rencontre purement fortuite après une aussi longue absence, a repris la conversation presque là où nous l’avions laissée.” Il se met à parler de l’architecture de l’ancien temple franc-maçon à l’intérieur de l’hôtel Great Eastern, qu’il vient de visiter. Mais il commence aussi une autre histoire: la sienne. Celle d’un petit garçon qui a grandi dans une bourgade du pays de Galles entre un prédicateur calviniste et sa triste femme, sachant qu’ils n’étaient pas ses parents mais ignorant d’où il venait. Il a vécu dans ce lieu d’austérité, de froid et de silence jusqu’à son départ pour l’école. Étudiant brillant, il s’est retrouvé boursier, puis étudiant à Oxford. C’est au moment de passer des examens qu’il a découvert son vrai nom, Jacques Austerlitz. Le professeur qui a entrepris des recherches sur ses origines afin de l’aider à se faire naturaliser n’a rien pu découvrir: les archives avaient brûlé, et le secret de la naissance d’Austerlitz avait disparu avec le prédicateur qui l’avait recueilli.
L’on comprend maintenant que le sujet du livre, c’est le secret de cette naissance, le secret que révèle Jacques Austerlitz à cette “oreille attentive” qu’est le narrateur, de façon très progressive, en expliquant comment sa mémoire a réussi à extraire ce secret de l’oubli.
C’est un livre sur la mémoire. Pas seulement sur celle d’un homme arraché à quatre ans à ses origines. Sur notre mémoire, à nous lecteurs. Sur cette mémoire dont parle Proust dans À la Recherche du temps perdu, qui n’est pas la mémoire intellectuelle mais l’autre, la mémoire involontaire, celle qui jaillit et restitue le passé à la faveur d’une madeleine trempée dans le thé, un passé qui est la seule vérité de notre être car la sensation le fait surgir dans sa pureté d’origine, non corrompue par nos défenses et nos reconstructions.
Chez Austerlitz les défenses sont très fortes. Elles l’ont poussé à se tourner vers un passé qui ne franchisse pas le seuil du vingtième siècle et à vouloir tout ignorer de l’Allemagne, pour lui “le plus inconnu des pays, plus exotique encore que l’Afghanistan ou le Paraguay.” Elles se manifestent sous forme d’une angoisse qui le ronge, qui le paralyse, qui l’empêche de poursuivre une relation avec la femme qu’il aime, et finit même par l’empêcher d’écrire, tant les mots lui paraissent faux, et les phrases incohérentes. Il est blindé contre le souvenir. Mais ses pas, à Londres, ne cessent de le ramener vers la Liverpool Street Station sans qu’il sache pourquoi, tout en sentant “un élancement continuel, une sorte de douleur cardiaque causée, je commençais à le soupçonner, par un courant qui m’aspirait vers le temps révolus.” À la page 190 du livre un lambeau de souvenir commence à affleurer, sous forme de l’image d’un petit garçon que le pasteur et sa femme étaient venus chercher, avec un petit sac à dos: “pour la première fois depuis que j’étais capable de mémoire, je me souvins de moi, en cet instant je compris que c’était par cette salle d’attente que je devais être arrivé en Angleterre plus d’un demi-siècle auparavant.” Et c’est alors qu’il est au bord de basculer du côté du souvenir qu’il entend deux femmes raconter à la radio comment, en 1939, elles ont été envoyées en Angleterre pas transport spécial et ont traversé toute l’Allemagne en train, jusqu’à la Hollande où elles se rappellent encore les ailes des moulins à vent. Austerlitz reçoit comme un choc électrique et comprend que cette histoire est la sienne. Elles ont voyagé sur un bateau qui s’appelait “Prague:” il ne peut se rappeler le nom du bateau qui l’a transporté en Angleterre, mais il sait soudain qu’il lui faut se rendre à Prague. Et c’est là, à Prague, quand il sent sous ses pieds les pavés disjoints de la ruelle où il est né—retrouvée miraculeusement dès son arrivée grâce à une fonctionnaire des archives qui lui a donné la liste des personnes portant son nom qui vivaient à Prague en 1938—que la mémoire lui revient, “non en faisant un effort de réflexion mais parce qu’à présent mes sens, qui avaient été si longtemps anesthésiés, à nouveau s’éveillaient.”
Je ne vais pas raconter dans le détail ce trajet à l’envers, ce voyage dans le passé d’un homme qui, à cinquante ans passés, retrouve ses origines, son histoire et le visage de sa mère. Je veux simplement conclure en disant que le procédé narratif de Sebald réussit à produire sur le lecteur l’effet de la madeleine proustienne. Ce passé que le lecteur n’a pas vécu mais connaît intellectuellement par les livres d’histoire, les documentaires, les films, la fiction et les témoignages, il le sent soudain en lui comme s’il était cette jeune mère qui met dans un train pour l’Angleterre un petit garçon de quatre ans qu’elle ne reverra pas, lui achète pour le voyage un album de Charlot et demande à une fillette plus âgée de prendre soin de lui. Il n’est pas possible de lire cette scène des adieux sur le quai de la gare Wilsonova à Prague, ce point d’arrivée du récit qui est aussi son point de départ, sans pleurer, sans doute parce qu’elle est écrite dans une langue calme, détachée, sans pathos. Le livre ne s’arrête pas là: Austerlitz nous livre ensuite tous les lambeaux de mémoire qui lui reviennent grâce aux récits de Vera, l’ancienne voisine de sa mère, qui le gardait quand il était enfant. C’est elle, Vera, qui lui raconte ce qui est arrivé à sa mère, Agata, arrêtée et déportée à Teresin en 1942, d’où elle n’est pas revenue, et à son père, Maximilien, qui a réussi à émigrer à Paris où il a été raflé en 1942. Comme le film de Lanzman, Shoah, le livre de Sebald nous permet de franchir les écrans de mémoire et de nous retrouver là-bas, de l’autre côté, dans l’horreur. Ce n’est possible que parce que nous avons traversé avec l’auteur le long couloir de sa méditation architecturale, que nous avons accepté d’entrer dans son rythme et de le suivre en un lieu “où le temps n’existe absolument pas.” Nous avons laissé tomber nos défenses, nous sommes passés du côté de l’Autre, et la récompense est là: un bout de vérité nue.
LA MADELEINE DE SEBALD
Par Catherine Cusset / Le 22 mai 2007 / Culture
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER

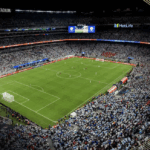
![[Webinaire] La carte verte EB2-NIW pour les entrepreneurs](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/07/webinaire-alexandra-merz-septembre-2025-150x150.png)