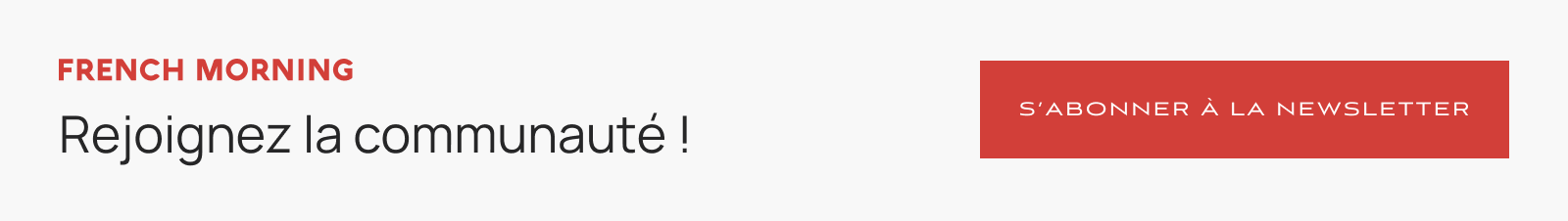Il est dix heures du matin chez Julien Farel. Il pleut des cordes sur Madison Avenue, mais le salon est chaud, douillet, et déjà bien rempli. « Salut, mon chéri ! », s’exclame une grande blonde aux airs de Charlize Theron. Elle a rendez-vous avec le maître des lieux, Julien Farel en personne. Bisous. Accolades. Plaisanteries, embrassades. Puis Julien l’assoit sur une chaise, et commence l’immuable rituel. Il se cale fermement derrière elle, pose les deux mains sur ses épaules, la regarde droit dans les yeux à travers le miroir et demande, sérieux : « Comment ça va aujourd’hui ? » Il est bientôt rejoint par une assistante, aux petits soins pour la cliente : veut-elle brancher son ordinateur portable ? Lire un magazine ? Déguster une boisson fraîche, ou un cappuccino ? Ce sont des détails, certes. Mais quand on facture 800 dollars la coupe, comme Julien Farel, chaque détail compte, et tout doit être parfait, de l’accueil au brushing, en passant par la décoration florale. « Mes clients ne viennent pas seulement pour une coupe de cheveux, explique-t-il. Ils viennent chercher de la compassion, de l’énergie, du bien-être. J’appelle cela l’art du service, ou encore l’amour du travail bien fait. C’est ce qui fait toute la différence, et c’est très difficile à enseigner. »
[ad#Article-Defaut]
C’est pourtant ce qu’il s’efforce de faire, à travers une charte de qualité, un « protocole », comme il l’appelle, destiné à harmoniser les pratiques de ses 60 employés. Un document qui devrait s’avérer de plus en plus utile à mesure que son affaire grandit. Car notre coiffeur de luxe a des ambitions. Huit ans après la création de son premier salon sur Madison Avenue, en effet, Julien Farel vient d’ouvrir une succursale à Cabo San Lucas, le Monte-Carlo du Mexique. Logé au sein de l’hôtel Capella, une nouvelle chaîne d’hôtels six étoiles developpée par Horst Schultze, l’ancien patron du Ritz-Carlton, le salon a été inauguré en septembre dernier. Et ce n’est qu’un début. « Nous nous sommes donnés deux ans pour tester le concept, indique Julien. Si tout va bien, nous pourrions ouvrir entre 20 et 50 salons dans le monde en partenariat avec les hotels d’Horst Schultze».
Mais d’abord, il va falloir traverser cette satanée conjoncture, qui a particulièrement affecté son business : « Comme je suis très cher, j’ai été le premier à trinquer. Depuis le début de cette crise, j’ai perdu 50% de mon chiffre d’affaires personnel en tant que coiffeur. Pas en tant que chef d’entreprise, heureusement, car nos tarifs démarrent à 150 dollars pour une coupe avec un Junior. » JF Gymnastique, la salle de sport « à la carte » inaugurée voici deux ans au dessus du salon de Madison Avenue, connaît elle aussi des difficultés. Et comme si cela ne suffisait pas, l’épidemie de grippe porcine s’est abattue sur le Mexique, compromettant le taux de remplissage de l’hotel Capella à Cabo San Lucas. « Je me suis retrouvé aux prises avec les deux crises de l’année, résume Julien Farel. Heureusement, je sens une nette amélioration. Mes clients commencent à revenir. »
Crise ou pas, Julien Farel ne relâche jamais la pression. Le parcours de cet infatigable travailleur, qui se fait des semaines de 100 heures, a demarré à Mautfoncon, un petit village près de Lyon. «J’hésitais à devenir footballeur, j’ai choisi la coiffure. » Il fait ses classes chez Jacques Dessange, qui l’envoie ouvrir une école à New York en 1992. Deux ans plus tard, il rejoint un des salons de Frédéric Fekkai, réputé pour avoir inventé la coiffure de luxe aux Etats-Unis. Julien décide ensuite de prendre le large en Italie, « mon deuxième pays », où il coiffe la jet-set internationale à domicile. 2001 signe son retour à New York, cette fois-ci pour se lancer de ses propres ailes. Marié à une Américaine et papa de deux petites filles, Julien a déjà prevenu sa famille qu’il ne prendrait pas de vacances pendant deux ans. « Il me reste dix ans pour travailler comme un fou, dit-il, et trouver des jeunes pour assurer la relève. Je veux qu’ils aient la passion du métier, comme moi. Pour ça, pas besoin de protocole. On l’a dans la peau ou on ne l’a pas.»
Julien Farel, 800 dollars la coupe
Par Claire Derville / Le 23 novembre 2009 / Actualité
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER