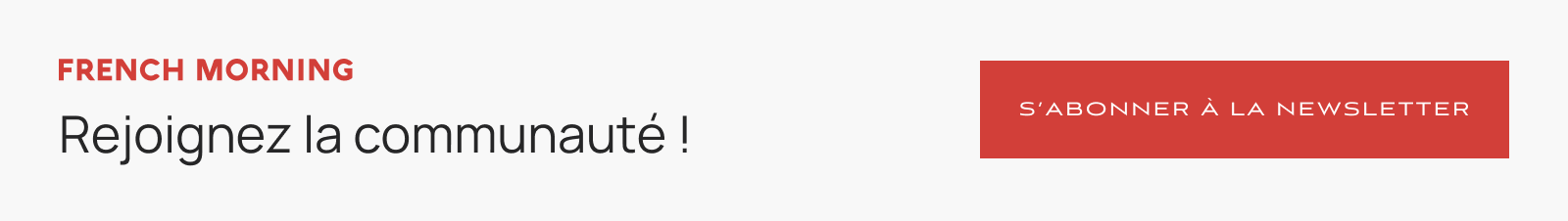Revue de presse. La France a peur de la nouveauté, son système de santé fait des jaloux et ses restaurants se paient la tête des clients. Voilà, en quelques mots, résumée l’actualité française vue par la presse américaine la semaine dernière.
La France craint la nouveauté, c’est en tout cas ce que laisse entendre un entrepreneur (français) dans les colonnes du site Quartz. L’auteur, Pascal-Emmanuel Gobry, analyse les réticences de notre pays à accueillir Netflix, l’entreprise américaine proposant des films sur internet. Pour lui, la raison est toute trouvée : la France a peur de ce qu’elle ne connait pas.
Netflix se retrouve devant une barrière bien française : l’«exception culturelle», permettant au gouvernement français de protéger les biens culturels de l’Hexagone. L’auteur n’est pas tendre avec son pays : «la France est à la traine depuis trente ans, avec une croissance très ralentie et un taux de chômage élevé». Pour lui, c’est la raison pour laquelle «le pays a du ressentiment et de la crainte pour ce qui vient de l’étranger». Il essaie néanmoins d’être optimiste en garantissant que malgré les obstacles, Netflix devrait finir par s’installer en France. Qui vivra verra…
La France aime les startups
Romain Dillet, journaliste au site Tech Crunch, n’est pas d’accord. Pour lui, la France est une « nation de startups ». En rentrant à Paris de New York, il raconte son étonnement face à l’intérêt des Français pour le lancement d’entreprises. « Les startups font partie de la culture, écrit-il, et beaucoup de la couverture médiatique consacrée à l’économie parle des startups et de l’innovation».
Après avoir passé en revue quelques-unes des pépites de la scène tech parisienne, il arrive à la conclusion que « la France ressemble à la scène des startups new-yorkaises d’il y a quelques années. Des jeunes gens passionnés essaient de créer un écosystème fonctionnel et cohérent ». Seul bémol : il faudra que les Gaulois progressent en anglais pour se faire connaitre.
Pour sa part, Claire Lundberg écrit dans Slate tout le bien qu’elle pense du système de santé en France. La jeune Américaine explique qu’après seulement six mois à paris, elle se rend compte qu’elle est enceinte. N’ayant pas de carte vitale et pensant devoir débourser des sommes pharaoniques (« vous pensez que cela me coutera plus de 1000 euros? » demande-t-elle à sa sage femme), elle réalise que le peu d’argent qu’elle devra sortir de sa poche lui sera par la suite remboursé intégralement.
C’est à peine croyable pour celle qui est habituée aux frais médicaux américains exorbitants (150 euros pour une visite chez un médecin). La maman a cependant un avertissement pour les Américaines qui souhaitent accoucher dans un hôpital français. « Si vous avez un bébé en France, attendez-vous à devoir apporter vos propres serviettes de bain à l’hôpital. Même s’il n’y a pas d’aspirine à 10 dollars, il n’y a pas grand-chose en terme de services, écrit-elle. Mais pour une prise en charge de qualité, et peu chère, je suis prête à apporter mon propre shampooing».
Piège du surgelé
Enfin, pour terminer cette revue de presse, le New York Times s’alarme : les restaurants français seraient de plus en plus nombreux à servir de la nourriture surgelée ou toute prête. Choqué, le journal rapporte que même le pain français, dans certaines boulangeries, peut avoir été préparé par de grands groupes industriels. « Pour les Français c’est un affront terrible à leur culture » ajoute le journaliste.
Tout en évoquant la solution de la vignette « fait maison », elle s’amuse néanmoins à rappeler que résoudre ce problème ne sera pas chose aisée, comme toujours en France. Elle nous donne cependant une petite astuce pour déjouer les pièges du surgelé : ne pas faire confiance aux restaurants dont la carte est très longue.
France, où est passée ta fougue?
Par FM / Le 3 février 2014 / Actualité
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER