« Et Angot, t’en penses quoi? » C’est une question parisienne. Une question presque inévitable dans le Paris de Saint-Germain des Prés. Une question qui comprend sa réponse: “Nul, non? Christine Angot, c’est un pur phénomène de mode. Comme l’autofiction, d’ailleurs. Il est temps d’en finir avec tous ces écrivains qui ne cessent de se regarder le nombril et qui ont tué le roman. Le roman existe. Il n’y a qu’à regarder du côté de l’Amérique.”
Je serais d’autant plus disposée à penser du mal de Christine Angot qu’elle m’a insultée deux fois. Dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, elle a écrit: “Catherine Cusset, Annie Ernaux, toutes ces bonnes femmes.” Ce devait être après la publication de Jouir en 97. À vrai dire j’ai été flattée qu’elle connaisse mon nom et qu’elle m’associe à Annie Ernaux, pour qui j’ai le plus grand respect. (C’est le moment de signaler une revue obscure, Trajectoires, qu’on trouve dans les bonnes librairies parisiennes ou sur l’internet, qui a récemment consacré un numéro à Annie Ernaux).
« Méchante! »
La seconde insulte d’Angot m’a touchée en un endroit beaucoup plus sensible: ma mère. Je venais de publier La haine de la famille. La Fnac m’a invitée à un événement sur l’autofiction et la difficulté d’écrire sur ses proches. Comme j’étais à New York, je leur ai suggéré d’inviter à ma place ma mère, qui pourrait parler de sa réaction à un livre qui la touchait intimement. Ma mère n’est pas écrivain. Le milieu littéraire l’intimide. Le modérateur l’a mise sur la sellette en premier. Christine Angot parlait après elle. Elle a presque réduit ma mère aux larmes en la traitant, elle, sa fille et les oeuvres de sa fille, de bourgeoises qui n’avaient rien à voir avec la littérature. Comme ma mère a une grande âme, ça ne l’empêche pas d’acheter Angot, de la lire, et même d’en dire du bien. Tandis que moi je n’ai qu’une envie: lui tirer la langue et lui crier: “Méchante!”
Je n’ai pas acheté son dernier livre, Rendez-vous. Dépenser 20 euros pour satisfaire une curiosité somme toute modérée? Ce serait oublier que je suis l’auteur des Confessions d’une radine. Angot, la plupart du temps, m’ennuie. Vous avez lu L’inceste, son plus grand succès? Des pages et des pages (deux-cents?) de déblatérations hystériques contre une malheureuse amante qui n’a pas envie de passer Noël avec elle, avant de parvenir aux pages croustillantes qui donnent son titre au livre. Là, il faut le reconnaître, c’est fort. D’autant plus fort qu’elle établit un lien direct entre son écriture décousue, destructurée, désordonnée, et l’inceste qui a cassé à jamais en elle l’ordre et la structure.
Je passais chez une amie, collaboratrice à French Morning que je ne nommerais pas pour ne pas attirer sur elle la vindicte d’Angot tellement obsédée par son image médiatique qu’elle est sans doute en train de lire cette chronique au moment même où je l’écris, quand j’ai remarqué Rendez-vous sur une étagère. J’ai été impressionnée de découvrir que la photo d’Angot sur la jaquette de couverture était l’oeuvre de Nan Goldin, une de mes photographes préférées et une grande artiste, dont la galerie Matthew Marks a montré récemment les photos et le film autobiographique sur le suicide de sa soeur et son propre rapport avec la folie. Angot est “in”, sans aucun doute. “Prends-le, m’a dit mon amie. Tu m’expliqueras.” Elle avait laissé tomber au bout de trente pages.
« Prouesse onaniste »
Pendant les cent premières pages j’ai eu du mal à ne pas laisser tomber. J’ai continué par inertie et pour échapper à un roman américain inspiré par le 11 septembre, qui me semblait complètement faux. Tant de fois, en lisant un roman, on a la sensation que c’est mort, que les mots, comme écrit Camille Laurens dans Ni toi ni moi (paru cet automne aussi, et que je vous recommande sans une hésitation) ont tous “été tirés d’un lieu extérieur à l’auteur,” “d’un dictionnaire, d’une caisse à outils.” On peut critiquer l’autofiction comme un exercice purement narcissique, mais quand l’auteur est un vrai écrivain—comme Serge Doubrovsky, Annie Ernaux, Camille Laurens—son investissement dans l’écriture fait que chacune des phrases vibre de vie et de présence. Quid d’Angot? J’étais curieuse. Mon intérêt pour son histoire avait beau être limité, j’avais beau trouver qu’elle écrivait mal, j’étais retenue par quelque chose, et me suis peu à peu laissée prendre.
Je me demandais si, contre toute probabilité, l’acteur dont elle livrait le nom, Eric Esteroza—avec qui elle avait lu un texte dans un théâtre et couché une fois, et qu’elle poursuivait depuis d’appels incessants—allait finir par la rappeler, s’ils finiraient ensemble et auraient beaucoup d’enfants, si l’auteur nous racontait une histoire heureuse. Cela semblait impossible. Haussant les sourcils, j’avais envie de lui dire: “You know, Christine, quand un mec ne rappelle pas, en général c’est mauvais signe. À quarante-cinq ans tu devrais savoir ça! Mieux vaut renoncer. Laisse les hommes venir à toi. Et pendant que tu y es, laisse aussi l’écriture venir à toi.”
Je n’arrivais pas à croire qu’elle soit si désespérément accrochée à l’attente d’un coup de fil et à l’écriture retraçant cette attente qui tissait un lien entre elle et l’absent, malgré toutes les tentatives de ce dernier de se dérober. Pauvre garçon, me suis-je dit plus d’une fois: quelle poisse d’être tombé sur Angot! Il avait beau faire le mort, c’était trop tard: il se retrouverait couché dans un livre. Je me demandais comment tout cela se terminerait. Il y avait, donc, du “suspense.” Angot avait réussi à m’accrocher. Son éditrice lui aurait rendu service en lui conseillant de couper soixante pages. Mais peut-être le lui avait-elle conseillé et s’était-elle heurtée à l’intransigeance d’Angot, qui doit avoir le sens du sacré quand il s’agit de son écriture.
Il y a dans l’écriture d’Angot, dans sa volonté de désigner l’acte d’écrire au moment même où elle écrit, quelque chose qui relève de la prouesse onaniste où on réussirait à se sucer soi-même—prouesse qui suscite, chez ceux qui y aspirent, le désir obsessif d’y parvenir. Au moment d’achever ce livre, ne sachant toujours pas ce que j’en pensais, mais l’ayant lu assez vite et regrettant presque de le quitter, j’ai songé que c’était cela, l’objet de la littérature: la folie d’une obsession.
“Et Angot, t’en penses quoi?”
Par Catherine Cusset / Le 6 avril 2007 / Culture
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER


![[Webinaire] L’assurance santé pour les Français·es des États-Unis](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/02/webinaire-17-fevrier-2026-150x150.jpg)
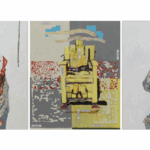
![[Vidéo] Contribuables américains : les obligations fiscales à respecter](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/12/Capture-decran-2026-02-04-a-11.04.50-150x150.png)
