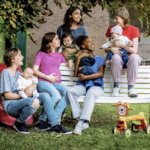Prendre un café en terrasse. Ce plaisir simple de la vie donne des migraines aux dirigeants du géant américain du café, Starbucks, en Europe. Le New York Times consacre un article aux difficultés d’adaptation de l’enseigne à la cafe culture européenne. Le quotidien rapporte que la marque est en train d’investir des millions de dollars dans ses établissements sur le Vieux Continent pour stimuler ses ventes. Dans ce grand dessein, la France, « pourrait représenter un challenge particulier », note le quotidien, qui commence l’article en citant Marion, une Parisienne qui boycotte Starbucks: « Je ne vais jamais à Starbucks, c’est impersonnel, le café est médiocre et cher. Pour nous, c’est une autre planète ». Le ton est donné. Eh oui, « marcher sur un Boulevard parisien avec un gobelet en carton à la main, ça ne se fait pas » ! souligne le Times. « Après huit ans à mettre en place 63 établissements, la compagnie n’a jamais réalisé de profit en France».
Que Starbucks se rassure, les réussites américaines en France existent : McDonald’s par exemple, ou encore Disneyland Paris. Ce petit morceau d’Amérique dans l’est-parisien fête cette année ces vingt ans d’existence. Un anniversaire qui n’a pas échappé à la presse américaine, d’autant que les chances de survie de Mickey et ses amis à Marne-la-Vallée paraissaient bien minces au début de l’aventure. Le Washington Post rappelle, en effet, que le succès du parc d’attraction était loin d’être acquis à son ouverture. Ce temple dédié à l’univers de l’Américain Walt Disney était vu par les uns comme « un Tchernobyl culturel« , « une menace » à la culture française. C’était « une construction en chewing-gum durci » pour les autres. Et le fait que le vin était banni dans les restaurants du parc à ses débuts n’a pas aidé : cela a été vu « comme une sorte de snobisme face à l’héritage français« , rappelle le Washington Post. Une période révolue puisque le Secrétaire d’Etat au Tourisme, Frédéric Lefebvre, s’est félicité des bonnes recettes du parc d’attraction et du fait que les Français constituent « la moitié des visiteurs ». « Le ronchonnement gaulois a cédé la place à l’enthousiasme », assure le Post. Comme dans les Disney, tout est bien qui finit bien !
L’anti-terrorisme à la française
Dans la vraie vie, en revanche, ce n’est toujours pas le cas. Le raid sur le logement du terroriste de Toulouse, Mohamed Merah, l’a rappelé. Dans un article intitulé « Fighting Terrorism, French-style » (on voit d’ici les agents du renseignement armés de leur baguette), le New York Times parle de « double échec » à propos de l’opération. Les services de renseignements français ont « échoué à identifier Mohamed Merah à temps » et les forces de l’ordre n’ont pas pu le capturer vivant.
Les Américains auraient-ils fait mieux ? C’est la question au cœur de l’article. Moyens, méthodes, organisation des services de renseignements, le correspondant du Times Steven Erlanger passe au crible les différences entre les dispositifs français et américain de lutte anti-terroriste. Les deux systèmes ont du bon, souligne Erlanger, mais reflètent surtout des traditions et des cultures différentes de part et d’autre de l’Atlantique. Il note ainsi qu’à cause de « leur histoire et en partie leurs budgets limités, les Français se reposent davantage sur le contact humain, le renseignement local et les ressources humaines plutôt que des écoutes et une surveillance automatisées, comme les Américains. » Et comme un article sur la France n’en serait pas un sans une allusion au traditionnel jacobinisme français, Erlanger observe qu’à l’inverse des Etats-Unis, la France a adopté un système de « centralisation de l’intelligence, l’Etat a accès à énormément d’informations mais sa marge d’action est très restreinte ».
« Bien que les mots dans les deux langues soient très similaires, les Américains et les Français n’ont pas du tout les mêmes notions de liberté, égalité et fraternité », note le journaliste, qui rappelle que « terrorisme » est un mot français, utilisé depuis 1789.
Mélenchon, « l’anti-capitaliste fougueux»
Pour finir, Bloomberg BusinessWeek revient sur la campagne présidentielle française. Le magazine constate que « les promesses de campagne des deux principaux candidats à la présidentielle penchent de plus en plus vers les extrêmes« . Si l’on accuse souvent M. Sarkozy de chasser sur le terrain du Front National, le reproche de la radicalisation est plus rare pour François Hollande. « Longtemps vu comme un socialiste modéré et ami des marchés financiers« , il « crie partout sa haine de la finance en plus de proposer de taxer les riches à plus de 75%« . Pour la journaliste, l’explication s’appelle « Jean-Luc Mélenchon« . Avec sa récente progression dans les sondages, « l’anti-capitaliste fougueux (…) mettrait la pression sur François Hollande » car il est « pugnace et a réussi à capter les mécontents« . La « Mélenchon-mania » n’en finit pas.