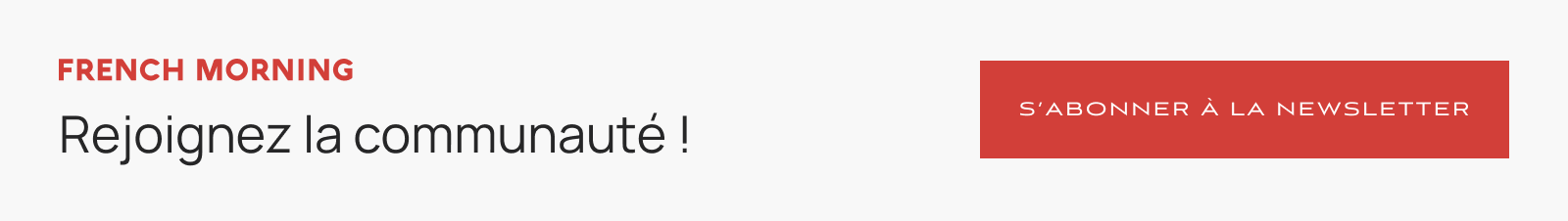« Les élections américaines de 2008 gagneraient à avoir un goût de France ». C’est écrit dans un éditorial de USA Today « Les Américains auraient des raisons d’envier – oserions nous dire « d’imiter » ? – certains aspects de la campagne » présidentielle française. » Parmi ses raisons : une participation à 84% (« contre 64 % en 2004 aux Etats-Unis »), une première candidate à la présidentielle (« même si Hillary Clinton pourrait la talonner de près »), la qualité du débat regardé par la moitié de la population française en âge de voter (« contre moins de 30 % pour le débat Bush Kerry »), et une « vraie différence » entre les candidats (« Sarkozy défend un traitement de choc un peu similaire à celui que Margaret Thatcher avait appliqué à la Grande-Bretagne » alors que Royal défendrait « les avantages sociaux du berceau à la tombe et les droits des employés, des politiques dont la France a de moins en moins les moyens »).
L’éditorial du Washington Post indique aussi une préférence pour Nicolas Sarkozy. Il serait « plus susceptible d’entreprendre les réformes économiques dont la France a désespérément besoin » veut croire l’édito qui rappelle, comme l’a fait celui de USA Today, qu’en 25 ans le PNB par tête français a chuté de la 7ème à la 17ème place dans le monde. « Sarkozy en comprend les raisons » selon l’éditorialiste du Washington Post alors que « Madame Royal a fait clairement comprendre qu’elle ferait empirer la sclérose ».
La préférence pour Sarkozy serait partagée dans la capitale américaine. « Ce n’est pas souvent que les politiciens américains ont un clair favori dans une élection présidentielle française » insiste l’édito. « Souvent le candidat le plus digeste est quelqu’un comme le président sortant Jacques Chirac qui définit sa politique en étrangère en opposition à celle des Etats-Unis ». Ce serait pour le Washington Post dans « ce moule » que se serait coulée Ségolène Royal. Alors que Nicolas Sarkozy « admire ouvertement les Etats-Unis ».
L’éditorial du Los Angeles Times compare aussi l’américanophilie supposée des deux candidats. Mais malgré l’image pro-américaine de Sarkozy, « ce serait une erreur de s’attendre à ce que la France soit plus alignée sur les Etats-Unis sous Sarkozy ». Car, rappelle l’éditorial, «comme presque tous les hommes politiques français, il était profondément opposé à la politique de la Maison Blanche en Irak et est favorable à un retrait des troupes françaises d’Afghanistan, ce qui pourrait bientôt s’avérer dangereux». Quant aux échanges commerciaux, « les deux candidats sont foncièrement français, c’est-à-dire protectionnistes ».
De toute façon, analyse Elaine Sciolino dans le New York Times, la politique étrangère n’a pas été un enjeu de ces élections. « Parfois les candidats avaient plus l’air de participer à une élection locale que de briguer la présidence d’une puissance nucléaire à la sixième économie mondiale. L’Irak et la relation de la France avec les Etats-Unis n’ont par exemple jamais été mentionnés » dans le débat. Ses extraits du débat sont gratinés. (« Non » répond t-elle. « Ah » dit-il.) «Leur ton faisait penser à un couple se chipotant à la table du petit déjeuner, avec le mari contenant mal son sentiment de supériorité et la femme l’attaquant parce qu’il n’écoute pas ».
Enfin pour ceux qui manquent encore d’informations sur les candidats, le New York Times publie en une un article consacré aux relations compliquées de Sarkozy aux immigrants. Le « possible prochain président » est « le fils d’un immigrant au nom pas très français qui a fait beaucoup, pour ne pas dire plus que n’importe quel autre responsable français pour améliorer le statut des minorités ». Il a même « défendu la discrimination positive à l’américaine, une hérésie pour beaucoup dans une France officiellement égalitaire et aveugle à la couleur de la peau ». Pourtant il est même persona non grata dans les banlieues, où son style a fait de lui « un ennemi pour beaucoup de jeunes minorités ».
Le Los Angeles Times consacre un article à Ségolène Royal. On l’a dite « froide », « autoritaire », « ambitieuse », « sans contenu »… et « tout cela venant de ses amis de gauche ». Mais cela ne nuit pas forcément à un candidat pro-changement de se faire allumer par l’establishment, fait valoir le quotidien.
« Son programme est un amalgame compliqué de gauche (35 milliards de nouvelles dépenses publiques), de droite (service militaire obligatoire pour les délinquants) et de centre (les étudiants seraient payés mais devraient enseigner). Son message est plus simple : la politique ça doit être souple. Et avec une mère courageuse au bon sens pratique à la tête du pays, tout se passera bien. Elle n’a ni grande vision historique, ni programme économique cohérent qu’on puisse résumer sur un autocollant. Ce qu’elle a, c’est une image de rupture avec le passé ».
Les Français ont effectivement besoin qu’on leur remonte le moral, insiste le Los Angeles Times « un sondage montrait la semaine dernière que les Allemands, les Italiens et les Espagnols ont tous une meilleure image de la France et de ses habitants que les Français ont d’eux et de leur pays ».
Dernière ligne droite
Par Guillemette Faure / Le 5 mai 2007 / Politique
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER