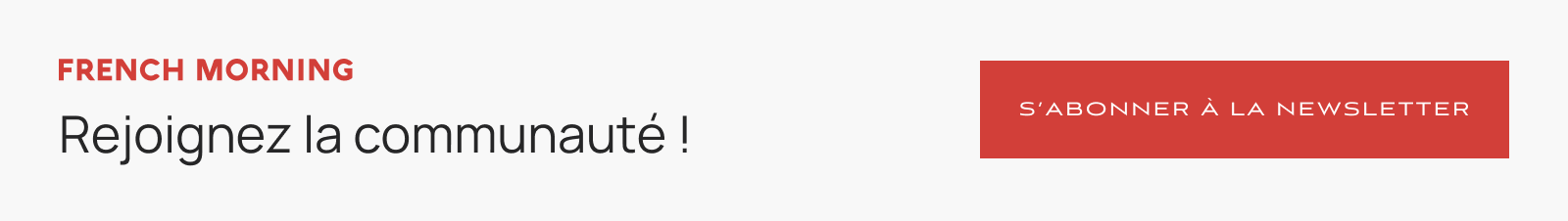Quand Walid Idriss commence ses cours de confection de pizza, il parle de l’histoire de son restaurant Macoletta à Astoria (Queens), de l’installation de son impressionnant four de 2 tonnes et montre des photos des stars pizzaiolos qu’il a rencontrées lors du salon international Pizza Expo à Las Vegas. En revanche, il parle très peu du parcours à rebondissements qui l’a mené de l’Algérie à New York. “J’ai eu mille professions”, sourit le restaurateur de 38 ans à l’énergie positive palpable, “et à chaque étape, j’ai beaucoup appris et rencontré beaucoup de gens“.
Dans sa première vie, à Alger, cet enfant de parents égyptiens scolarisé au lycée français de la ville était un amoureux de maths et de pizza. Celle de sa mère pour être précis. “Comme nous n’avions pas de produits surgelés, ma mère faisait tout de A à Z, dit-il. Quand elle n’était pas en cuisine, je m’amusais avec la farine et j’essayais d’étaler la pâte. Ça mettait le désordre, mais j’ai toujours aimé ça !“.
Le jeune homme a une autre obsession: les États-Unis, où son grand frère s’est installé après avoir gagné la carte verte en 1993. Après trois petits mois dans une université sélective, Walid Idriss parvient à convaincre ses parents de lui payer un billet d’avion entre Paris (où le footeux allait disputer un tournoi sportif) et New York. Il n’est jamais reparti. “J’avais visité la ville quand j’avais 8 ans. J’étais fasciné par la dimension des rues, les véhicules, l’ambiance… et les parts de pizza à 1 dollar. Elles me paraissaient énormes à l’époque. Enfin, elles le sont vraiment !”
Aux États-Unis, il a tout de même un petit problème: “quand il est arrivé à New York, mon frère avait la carte verte. Moi, j’avais un visa de touriste !“. Pour rester dans la légalité et progresser en langue, il rejoint une école d’anglais avant d’être admis à l’université Baruch, où il étudie l’actuariat (l’évaluation des risques) et les mathématiques financières. Comme il faut bien vivre, il enchaine les jobs dans les restaurants français, comme Pastis, Café d’Alsace et Madison Bistro, du chef Claude Godard. “J’ai toujours aimé la restauration. Quand j’étais jeune, je voulais aider ma mère en cuisine, même si les garçons n’y étaient pas admis“.
Il n’y a pas que dans les restaurants qu’il trouve de quoi financer sa vie américaine et ses études: installé à Nyack (New York) avec son oncle, il travaille pendant quelques temps dans les stations-services, où il est chargé de faire les pleins. Quelques mois plus tard, les propriétaires libanais le chargent de la supervision de plusieurs de leurs pompes à essence dans le Bronx et en banlieue de New York. “Ça se mariait bien avec les études car je faisais mes tournées de stations-services le matin et j’étudiais le reste du temps“. Bizarrement, son ingénieur de père ne partage pas son enthousiasme pour les stations-services. “Mes parents avaient peur que je perdais mon temps. Ils voulaient que je rentre en France, se souvient Walid Idriss. Mais pour ma part, je voulais leur prouver que je pouvais faire ma vie ici“.
Ambitieux et un brin “têtu“, l’Algérois a l’habitude de “tout faire à 120%“. Quand il s’inscrit pendant ses études dans un cours de Kung fu pour avoir un passe-temps sain et faire des rencontres, il termine en équipe nationale américaine. “Je me suis investi dans l’école d’arts martiaux que je fréquentais et ils ont aimé mon énergie. Le maître était champion du monde et coach de l’équipe américaine“. Après des essais concluants en Indiana, il s’en va porter les couleurs de l’Oncle Sam dans des tournois internationaux. Peu importe s’il n’a pas encore la nationalité américaine. “Ce qui est bien aux États-Unis, c’est que ton origine, ta religion, c’est secondaire”, dit-il.
Mais s’il y a bien un domaine dans lequel cet “over achiever” n’a pas souhaité persévérer, c’est le monde de la finance. Après plusieurs expériences à sa sortie de Baruch College, il rejoint en 2015 la banque française Natixis à New York comme vendeur de produits dérivés. Deux ans plus tard, il est essoré. “La concurrence était intense. C’était de la concurrence en cravate, avec des gens issus de grandes écoles et de l’Ivy League. Tous les jours, nous étions comme des soldats qui allaient au front. J’étais devenu une autre personne“.
En 2017, il rejoint donc les légions de reconvertis de la finance en renouant avec ses premiers amours – la pizza – et signe le bail de Macoletta, à Astoria. Le projet est inspiré du bar à vins italien de l’un de ses anciens collègues de Madison Bistro. Tout en exerçant une activité “plus relax” dans une banque israélienne, il supervise le chantier de son futur restaurant et l’ouverture en 2018, avec l’aide de son ancien patron Claude Godard et les fonds de deux investisseurs français notamment. “Je pensais que le projet allait me coûter 250 000 dollars, mais ça a fini par être le double !“, s’exclame le restaurateur.
Le résultat: un restaurant-bar à vins humble et chaleureux, à l’image de son propriétaire, dont le mobilier a été réalisé par les Français de Chateau Brooklyn. Son pari: proposer une pizza napolitaine avec des touches du bassin méditerranéen (pissaladière, merguez…). “Je ne peux pas dire aux clients que je suis italien. J’utilise les mêmes ingrédients mais je donne à la pizza un accent égyptien, algérien. On peut faire ça à New York“, reprend-t-il.
Quitter un business stressant pour un autre business stressant (et encore plus pendant la crise sanitaire), cela valait-il vraiment le coup ? “Tout ce que je fais au restaurant dépend de ce que je donne. En finance, même si tu mets 120 heures et que tu travailles dur, il n’y a rien à faire si ton boss ne t’aime pas“. Du monde de la finance, le restaurateur a au moins retenu une leçon: “J’étais toujours nerveux avant les revues de performance avec mes boss, mes superviseurs. J’essaye de ne pas mettre ce stress et cette nervosité sur les épaules de mes employés aujourd’hui“.
Bonne nouvelle: ses parents, qui habitent désormais aux États-Unis, ne veulent plus le voir devenir ingénieur ou rentrer au bercail. “Quand ils viennent au restaurant, dit-il, ils sont très fiers“.





![[Webinaire] La carte verte EB2-NIW pour les entrepreneurs](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/07/webinaire-alexandra-merz-septembre-2025-150x150.png)