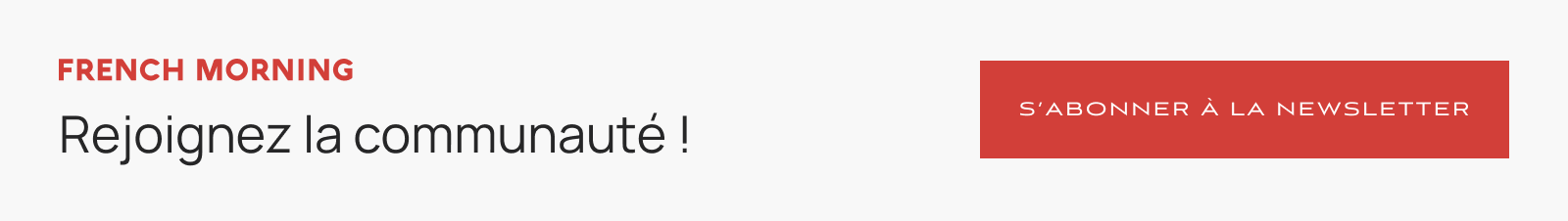“Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme d’une petite Française déterminée”, plaisantait Agnès Varda, après avoir reçu son Oscar d’honneur à Hollywood, en novembre 2017. Depuis la disparition de la cinéaste, vendredi 29 mars, à l’âge de 90 ans, la presse américaine emploie des qualificatifs beaucoup plus grandiloquents. Le New York Times parle d’une “Grande Dame du cinéma français”, quand le Hollywood Reporter fait l’éloge d’une “pionnière dans la réalisation de films et d’une figure du féminisme”.
“Je me souviens d’un déjeuner avec des critiques cinéma de Los Angeles à la fin des années 90. Pour eux, c’était un personnage culte, emblématique. Son état d’esprit, comme sa liberté de création, fascinaient les Américains”, raconte François Truffart, le directeur du festival de films français de Los Angeles Colcoa, qui l’avait rencontrée lorsqu’il était attaché audiovisuel pour l’Ambassade de France à Tokyo. Il la compare volontiers à “la version féminine de François Truffaut”.
Et cet amour était réciproque. “La ville de Los Angeles m’a énormément inspirée, ses immeubles assez bas, les gens différents… La ville sent le cinéma, donne envie de faire des films”, racontait la cinéaste auteure lors de la présentation de l’exposition “Agnès Varda in Californialand” au musée d’art moderne de la ville (LACMA), fin 2013. Fascinée par ses plages, et notamment Venice Beach et Santa Monica, Agnès Varda réalisa entre 1967 et 1980 six films ayant pour décor la Californie. parmi eux, le court-métrage “Uncle Yanco” (1967) un portrait de son “oncle d’Amérique” Jean Varda, le documentaire sur les manifestations à Oakland liées au procès de Huey P. Newton “Black Panthers” (1968) ou encore “Mur Murs” (1980) sur les fresques murales de la cité des anges. Et ses films font partie des annales locales. “Mon documentaire «Daguerréotypes» – sur les commerçants de la rue Daguerre à Paris – est étudié dans les universités californiennes”, se réjouissait-elle, lors d’une interview.
Los Angeles avait une place particulière dans son coeur. Elle y a effectué une partie de sa carrière dans les années 60 puis à la fin des années 70, aux cotés de son mari, feu le réalisateur Jacques Demy. Cette artiste polyvalente, qui démarra sa vie professionnelle comme photographe et se découvrit plasticienne à 70 ans, s’y était fait de nombreux amis dont Andy Warhol, Jim Morrison et Francis Ford Coppola. “Partout où elle allait, elle développait un carnet d’adresses”, rappelle François Truffart, qui avait aussi le droit aux attentions d’Agnès Varda. “Elle m’avait appelé il y a un an et demi pour savoir comment se passait la préparation de Colcoa.” Ses visites dans la cité des anges étaient régulières, d’autant plus que son fils Mathieu Demy y est installé.
C’est lors de ses nombreux va-et-vient que sa route re-croise celle de Gwenaël Deglise, une étudiante qu’elle avait brièvement rencontrée à Paris. “Elle m’avait parlé de son fils qui vivait à Los Angeles, et de la rétrospective sur son travail que préparait l’American Cinematheque (l’Aero Theatre et l’Egyptian)”, se remémore t-elle. Quelques mois plus tard, Gwenaël Deglise, alors stagiaire pour l’institution, reprend contact avec ce monument du cinéma. Elle devient alors son assistante personnelle, l’aide sur son temps libre quand elle est de passage à L.A. “C'(était) une vraie voyageuse qui aimait Los Angeles”, insiste-t-elle. Plus tard, alors que la réalisatrice prépare “Les plages d’Agnès”, elle s’intéresse particulièrement à l’histoire de cette étudiante parisienne, venue sans argent et sans connaître un mot d’anglais. Se déplaçant sur son vélo rouge, elle enchaînait les petits boulots, et s’occupait d’un petit café sur Wilshire et La Brea où étaient organisées des projections.
Ce “chouette petit café” va nourrir l’imagination d’Agnès Varda. Elle réalise alors le court-métrage “Gwen La Bretonne”, qui ne sera finalement jamais incorporé aux “Plages”, mais présenté à l’Aero Theatre à Los Angeles. “C’était très charmant, un bel hommage”, se souvient Gwenaël Deglise, aujourd’hui directrice des programmes de l’American Cinematheque. Et elle lui a rendu la pareille, vendredi, en affichant sur la devanture de l’Aero Theatre ces quelques mots : “Agnès Varda, 1928 – 2019, We love you”.
La relation entre les deux femmes était telle que la cinéaste est restée fidèle à l’American Cinematheque pour présenter ses films. Une loyauté qu’admire François Truffart qui aimerait, après plusieurs occasions manquées, présenter le dernier film d’Agnès Varda ou un de ses classiques lors de Colcoa 2019.
Malgré sa passion ardente pour les Etats-Unis, cette artiste se considérait toujours comme “un objet culturel cinématique” pour Hollywood. “Contrairement aux blockbusters, mes films n’ont jamais fait d’argent”, ironisait-elle d’ailleurs. Elle racontait à French Morning, il y a un an et demi, être “une réalisatrice à la marge”. “Un film ne doit pas illustrer mais avoir son propre langage.”. Une liberté de ton qui était admirée chez la réalisatrice de la Nouvelle vague.
Mais cette force et cette énergie disparaissaient quand il était question de promotion. Pour la campagne de “Faces, Places”, nommé comme “meilleur documentaire” aux Oscars 2018, JR avait sillonné les Etats-Unis avec une pancarte représentant Agnès Varda. “Je ne veux plus faire partie du système de la distribution”, confiait celle qui se disait “fatiguée” par la promotion. Elle s’était tout de même rendue à Hollywood pour recevoir une dernière preuve de cette histoire d’amour: un Oscar d’honneur en 2017. “Un rêve” qu’elle a accompli.